Las du triste hôpital et de l’encens fétide
Qui monte en la blancheur banale des rideaux
Vers le grand crucifix ennuyé du mur vide,
Le moribond, parfois, redresse son vieux dos,
Se traîne et va, moins pour chauffer sa pourriture
Que pour voir du soleil sur les pierres, coller
Les poils blancs et les os de sa maigre figure
Aux fenêtres qu’un beau rayon clair veut hâler,
Et sa bouche, fiévreuse et d’azur bleu vorace,
Telle, jeune, elle alla respirer son trésor,
Une peau virginale et de jadis ! encrasse
D’un long baiser amer les tièdes carreaux d’or.
Ivre, il vit, oubliant l’horreur des saintes huiles,
Les tisanes, l’horloge et le lit infligé,
La toux ; et quand le soir saigne parmi les tuiles,
Son œil, à l’horizon de lumière gorgé,
Voit des galères d’or, belles comme des cygnes,
Sur un fleuve de pourpre et de parfums dormir
En berçant l’éclair fauve et riche de leurs lignes
Dans un grand nonchaloir chargé de souvenir !
Ainsi, pris du dégoût de l’homme à l’âme dure
Vautré dans le bonheur, où ses seuls appétits
Mangent, et qui s’entête à chercher cette ordure
Pour l’offrir à la femme allaitant ses petits,
Je fuis et je m’accroche à toutes les croisées
D’où l’on tourne le dos à la vie, et, béni,
Dans leur verre, lavé d’éternelles rosées,
Que dore la main chaste de l’Infini
Je me mire et me vois ange ! et je meurs, et j’aime
— Que la vitre soit l’art, soit la mysticité —
À renaître, portant mon rêve en diadème,
Au ciel antérieur où fleurit la Beauté !
Mais, hélas ! Ici-bas est maître : sa hantise
Vient m’écœurer parfois jusqu’en cet abri sûr,
Et le vomissement impur de la Bêtise
Me force à me boucher le nez devant l’azur.
Est-il moyen, ô Moi qui connais l’amertume,
D’enfoncer le cristal par le monstre insulté,
Et de m’enfuir, avec mes deux ailes sans plume
— Au risque de tomber pendant l’éternité ?
Stéphane Mallarmé, Vers et Prose, 1893
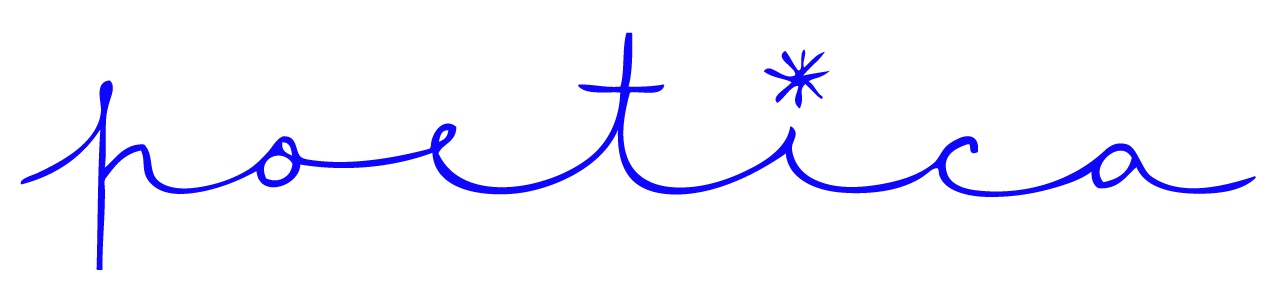

Poème représentatif de la phase baudelairienne de Mallarmé, avec une structure semblable à celle de l' »Albatros » : une allégorie exposée dans un premier temps, dont l’interprétation est donnée dans un second temps.
« Ainsi » (pour reprendre le connecteur logique explicatif du début de la sixième strophe) le moribond des cinq premières strophes qui bave à la fenêtre comme seule médication possible à son désespoir n’est autre que Mallarmé « pris du dégoût de l’homme » et qui « s’accroche à toutes les croisées » pour tourner le dos à la (fausse) vie et tenter de se sauver…
Les deux dernières strophes marquent une sorte d’épilogue douloureux à la grande vision de derrière la vitre qui se voulait salvatrice, son échec en quelque sorte (« Mais, hélas ! »), et évoquent la pensée qui caresse un moment le poète d' »enfoncer le cristal » de la fenêtre qui, d’ouverture au ciel qu’elle était au départ, est devenue prison de verre ne le protégeant même plus de la Bêtise envahissante du monde, et céder enfin à la tentation d’Icare…
A noter que le regard de Mallarmé aborde les fenêtres dans le sens inverse au regard de Baudelaire qui, lui, porte sa vue de l’extérieur vers l’intérieur, vers la vie intérieure et secrète qui se déroule dans la pièce sombre éclairée à la lumière de la chandelle.
Pour Mallarmé, au contraire, la fenêtre est ce qui ouvre au monde, elle est abordée de l’intérieur vers l’extérieur, vers le ciel et la Beauté, mais la beauté filtrée par le verre (le cristal) de la croisée : ce qui donne au spectacle sa dimension artistique ou mystique, et donc « civilisé », « humanisé » (traité par l’homme), spectacle aperçu au milieu d’un cadre ou vu à travers un vitrail.
Le poète y contemple d’ailleurs son image reflétée : « il se mire et se voit ange ».
Ouvrez la fenêtre, « enfoncez le cristal », et vous êtes alors dans la nature brute, sauvage, et plus rien ne vous empêche de faire le grand saut pour quitter la vision artistique ou mystique, et plonger dans la mort brutale…
Je voudrais pour finir m’attarder sur les deux moments qui sont les sommets de l’œuvre : les visions parallèles du moribond à la cinquième strophe, et du poète à la huitième.
Il y a d’abord ces « galères d’or, belles comme des cygnes, sur un fleuve de pourpre et de parfums » qui illuminent l’œil du moribond et le nôtre par la même occasion. La métrique y est parfaite, collant complètement à la syntaxe de la phrase : cette vision grandiose est statique et apaisée.
Et puis surgit de nulle part, comme une vague de fond, ce vers à couper le souffle du début de la huitième strophe : « Je me mire et me vois ange ! et je meurs et j’aime »…
Nous ne sommes plus dans la contemplation sereine de la vision précédente : ici il s’agit de l’élan spirituel de l’âme sortant d’elle-même pour rejoindre ce « ciel antérieur » (posé devant le poète au travers de la vitre, ou ciel platonicien ?) et s’unir à lui dans et par la vitre qui reflète le visage du poète.
Et là, la syntaxe n’est plus du tout en accord avec le mètre comme dans la vision précédente : le vers est tout mouvement, avec ce fantastique rejet à la césure de « ange », et sa voyelle nasalisée qui ouvre le souffle et exprime le saut, qui n’est pas celui de la mort abordé à la fin du poème, mais celui de la Vie, de « la vraie Vie qui est ailleurs » (comme dirait Rimbaud)… et tout ceci magnifiquement soutenu, relancé par cette polysyndète en « et » qui poursuit à l’infini la lancée et la montée vers la grande vision finale de la Beauté qui clôture la strophe : l’époptie !
Et il n’y a plus rien à rajouter…
Un poème riche en émotion qui invite a la réflexion à propos des fenêtres.
Bravo François !
Magnifique et intriguant, un poème qui interroge plus qu’il ne répond.