PREMIÈRE PARTIE : LE BERCEAU
Fraîche plante à la fraîche haleine,
Fleur éclose sur mon écueil ;
O toi qui de la vie à peine
Viens de franchir le triste seuil ;
Fragile enfant, jeune âme blanche,
Premier bouton de mon été,
Que Dieu suspendit à ma branche
Pour en voiler l’aridité ;
Douce ignorante de la vie,
Pur vase à la pure liqueur,
Dans mon ombre aube épanouie
Pour verser le jour à mon cœur ;
Sœur des anges au blond visage,
Qui demi-nus, aux bords du ciel,
Se bercent dans l’or d’un nuage
Sur les toiles de Raphaël ;
Esprit de quelque sphère heureuse,
Qui sur les neiges de ton corps
Gardes la trace lumineuse
Du monde inconnu d’où tu sors ;
Toi qui de cette coupe amère
Où l’homme puise et se nourrit,
Ne sais que le lait dont ta mère
Blanchit ta lèvre qui sourit ;
D’où vient, jeune âme à peine née,
Qu’arbre penché sur l’arbrisseau,
Sondant déjà ta destinée,
Je rêve auprès de ton berceau ?
D’où vient qu’à l’heure des étoiles,
Quand le sommeil est sur tes yeux,
De ton sort entr’ouvrant les voiles,
Je veille austère et soucieux ?
Pourtant tout te sourit, tout fête,
Enfant, ta bienvenue au jour ;
Pour baiser ta soyeuse tête
Les anges quittent leur séjour.
Ta joue a l’incarnat des roses,
Tes yeux ont la couleur du ciel,
Et tes cheveux, boucles écloses,
Sont doux et blonds comme le miel.
Sais-tu pourquoi mon âme est sombre
En évoquant ton avenir ?
Pourquoi dans mes yeux baignés d’ombre
Je sens presque des pleurs venir ?
C’est qu’à travers jeunesse et grâces,
Moi qui sais la vie et ses pleurs,
Je vois accourir sur tes traces
L’essaim des humaines douleurs.
Bientôt – peine cuisante et vive ! –
Tes dents de perle au frais émail
Feront, en ouvrant ta gencive,
Pâlir tes lèvres de corail.
Faible, sur ta mère affaissée,
Tu penches ton front abrité,
Comme une tige qu’a blessée
Le dard brûlant d’un jour d’été.
Contre le sort frêle et sans armes,
De ton mal tu te plains à Dieu ;
Et le flot cuisant de tes larmes
Ruisselle sur ta joue en feu.
Ta mère, hélas ! la pauvre femme,
Berce ton corps souffrant et cher ;
Et moi je sens pleurer mon âme
Et gémir la chair de ma chair.
Oh ! quel spectacle pour nos doutes,
Nous qu’oppresse un poids étouffant,
Que des larmes à larges gouttes
Pleuvant des beaux yeux d’un enfant !
Dieu ! ta justice est un mystère !
Les plantes, les oiseaux, les fleurs
Ainsi que nous sur cette terre,
Ne croissent point dans les douleurs.
Tout est heureux dans la nature,
Tout vient et s’en va sans souffrir ;
Et ta plus noble créature
Souffre pour naître et pour mourir !
Pourquoi faire souffrir l’enfance ?
Seigneur ! quel est ton but caché ?
Cet âge est faible et sans défense,
Cet âge est blanc de tout péché !
Pourquoi dans un même anathème,
Confondant nos jours désolés,
Des pleurs infliger le baptême
A ces beaux fronts immaculés ?
Hélas ! pourquoi te faire craindre ?
Nés pour sourire et pour aimer,
Ils sont sans force pour se plaindre,
Comme sans voix pour blasphémer.
Vêtus de leur sainte innocence,
D’un nimbe invisible embellis,
Ils vivent nus en ta présence,
Comme les anges et les lys.
Lacs de céleste azur dont l’onde
Réfléchit ta sérénité,
Ils sont encor dignes d’un monde
Jamais perdu ni racheté.
O souffrance ! breuvage austère,
Coupe pleine de châtiment
Que l’homme et l’enfant sur la terre
Doivent vider également ;
Souffrance ! ta main est cruelle,
Car tu frappes des mêmes coups
Le plus robuste et le plus frêle,
Le plus méchant et le plus doux !
DEUXIÈME PARTIE : L’ENFANCE
Mais déjà plus souple et plus belle,
La tige commence à grandir ;
Brisant son écorce rebelle,
Du bouton la fleur va sortir.
O folle enfance ! ô tête blonde !
Baisant tes yeux à leur réveil,
En vain je boude, et je te gronde,
Enfant, de courir au soleil ;
Toi, t’envolant avec l’aurore,
Par nos vallons pleins de douceurs,
Tu veux voir les bourgeons éclore,
Avec les abeilles tes sœurs.
Quand l’aube à la molle paupière,
Aux yeux d’azur comme la mer,
Des flots lactés de sa lumière
Blanchit le cristal bleu de l’air ;
A l’heure où l’insecte qui rôde
Sent le jour dorer ses habits,
Où sur les feuilles d’émeraude
Luisent les mouches de rubis ;
A l’heure des chastes délices,
Où tout renaît pour embaumer,
Où les âmes et les calices
S’ouvrent pour vivre et pour aimer ;
Joyeuse, avant nous tu t’éveilles,
Et tu vas au milieu des champs
Mêler à toutes ces merveilles
Ton âme, tes jeux et tes chants.
Du gazon verdoyant et lisse
Effleurant l’humide velours,
Fille de l’air et du caprice,
Sans but, tu fuis, tu viens, tu cours.
Ainsi qu’un papillon de soie
Qui nage dans l’air transparent,
Par la vallée où l’aube ondoie,
Je vois passer ton vol errant.
L’herbe par le ciel arrosée,
Et l’arbuste ami de tes jeux,
Sèment leurs larmes de rosée
Sur les fils d’or de tes cheveux.
Là, parmi les vertes ramées,
Tu vois, sur des rameaux pendants,
De belles grappes parfumées
Qui font rire tes belles dents.
Là, les bibaciers aux fleurs blanches,
Chargés des gouttes de la nuit,
Laissent pour toi choir de leurs branches
Les perles d’ambre de leur fruit.
Là, tu bois une eau vive et fraîche,
Qui reflète en ses flots moirés
Ton beau visage au teint de pêche
Et tes yeux bleus aux cils dorés.
Ici, splendide comme un rêve,
La plaine au jour vient de s’ouvrir ;
Plaine où toute aile qui s’élève
Semble t’inviter à courir.
Ici, sur le bambou qui ploie,
Roseau sonore et frémissant,
Comme un cactus ardent, flamboie
Le cardinal éblouissant.
Ici, l’arbre au superbe ombrage,
Déployant ses larges rameaux,
Berce au vent son vaste feuillage
Où pendent des grappes d’oiseaux.
Ainsi tout t’appelle et t’enchante,
Tout invite et séduit tes yeux,
L’eau qui parle, le nid qui chante,
Le soleil qui remplit les cieux.
O joie ! ô fleurs ! ô mélodie !
Mais l’astre monte et, plus puissant,
Au ciel que sa marche incendie
Roule son disque incandescent.
Déjà dans les grands champs de cannes,
Dans les déserts du firmament,
Et sur les monts, dans les savanes,
Déjà tout n’est qu’embrasement.
Nul vent, nul souffle qui balance
L’oiseau gazouillant sur l’épi :
Partout plane un ardent silence,
L’ardent silence de midi !
Sous le soleil, mornes et calmes,
Les palmiers aux fronts panachés
Laissent traîner leurs larges palmes
Sur les bœufs à leurs pieds couchés.
Cherchant l’ombre pour leurs paupières,
Aux rayons pleuvant du zénith
Le lézard glisse entre les pierres,
Le bengali vole à son nid.
Dans l’arbre où sa voix se recueille,
Le ramier n’a plus un soupir ;
L’herbe même ferme sa feuille,
Se penche et semble s’assoupir.
O poids du jour ! ô lassitude !
Pâtres et fleurs ont clos les yeux.
Le soleil dans sa plénitude
Brûle immobile au fond des cieux !
Mais, tandis que la plante et l’homme,
Courbés sous un ciel étouffant,
Par ce soleil font un doux somme,
Toi, que fais-tu, ma douce enfant ?
Assise au plus creux des ravines,
Près de quelque source où tu bois,
Tu goûtes ces fraîcheurs divines,
Mystère des eaux et des bois.
Du dôme épais que l’astre inonde,
Mobile et vivant parasol,
Filtre une clarté molle et blonde
Sur la mousse fine du sol.
Toi, du pied frappant l’eau captive,
Tu troubles de tes joyeux bonds
La poule d’eau bleue et furtive
Qui sommeille au milieu des joncs.
Folâtre, rieuse, éveillée,
Glanant des fruits, cueillant des fleurs,
Tu fais partir sous la feuillée
Le vol lourd des merles siffleurs.
Fraîche oasis, tiède Élysée,
Oh ! ne versez, arbres cléments,
Qu’une lumière tamisée
Sur cette tête aux jeux charmants !
Cependant le soleil qui baisse
De moins de flamme emplit les airs ;
Chargé d’arôme et de mollesse,
Un vent plus frais souffle des mers.
Voici que le morne aux pics sombres,
Debout là-bas comme une tour,
Étend ses gigantesques ombres
Sur les savanes d’alentour.
Voici que le Blanc des montagnes,
Le Blanc, effroi du Noir marron,
Revient au loin par les campagnes
Vers les palmiers de sa maison.
Voici qu’aux feux crépusculaires,
Des flots quittant les profondeurs,
Vers les caps où pendent leurs aires
Revolent les oiseaux pêcheurs.
Dans son lit de pourpre et de lame
L’astre se couche, large et pur ;
Avec lenteur son œil de flamme
Ferme ses paupières d’azur.
Tel qu’un grand vol d’esprits funèbres,
Sur la terre où s’éteint tout bruit,
D’un bond s’abattent les ténèbres…
C’était le jour, et c’est la nuit.
Reine des soirs, vierge au front pâle,
Fuyant son humide prison,
Dans sa nef de nacre et d’opale
La lune monte à l’horizon.
Salut à toi, beauté sereine,
Rêveuse aux regards amollis !
Verse-nous, verse, ô vierge-reine,
Tes rayons blancs comme le lys !
Et le tableau s’éclaire et change,
Et sous l’ambiante lueur
Tout se confond, tout se mélange,
Ombre et contour, forme et couleur.
Et telles que des pâquerettes,
Filles du nocturne zéphyr,
Mille étoiles s’ouvrent discrètes,
Blanches sur un champ de saphir.
Et tout est repos et mystère,
Et le silence est solennel,
Et l’on sent respirer la terre,
Et l’on voit sourire le ciel.
Alors, à la chaste lumière
Des belles étoiles de Dieu,
L’enfant au ciel fait sa prière,
A son ange elle dit adieu,
Et, loin de tout souffle profane,
Elle dort, rose de santé,
D’un sommeil pur et diaphane
Comme nos claires nuits d’été.
Oh ! dors ton sommeil d’innocence,
Ce pur sommeil des heureux jours !
Des bonheurs calmes de l’enfance,
Vois-tu, l’on se souvient toujours.
Gerbes d’or ou gerbes fanées,
Quelques épis qu’on glane ailleurs,
Les épis des jeunes années,
O ma fille ! sont les meilleurs.
Quand vient la vieillesse morose,
Quand vient l’âge aux soucis rongeurs,
Vers son enfance gaie et rose
On se tourne les yeux en pleurs.
Et l’on s’arrête avec envie
A cet âge aimé du Sauveur,
Qui joue aux portes de la vie
Sans se douter de son bonheur.
Chante, oiseau ! ton jour vient d’éclore.
Vis dans les champs ! vis dans les bois !
Sois jeune ! il en est temps encore.
L’homme, hélas ! ne l’est qu’une fois.
Bientôt viendront les jours d’études
Les jours d’école et de leçons.
Adieu les vertes solitudes !
Adieu la plaine et les buissons !
Alors, plus de jeux, plus de course !
Il te faudra, dès le matin,
Porter ton esprit à la source
D’où coule le savoir humain.
Buvant de cette veine austère
Le flot lent et silencieux,
Souvent à son eau salutaire
Se mêlera l’eau de tes yeux.
Mais, crois-moi, tous tant que nous sommes,
Nous fécondons avec nos pleurs ;
Et le grain qui nourrit les hommes
Ne mûrit que par nos sueurs.
Va ! toute noble créature
Du travail connut les rigueurs ;
Et l’étude est la nourriture
Dont s’alimentent les grands cœurs.
A sa clarté sereine et sûre
Elle agrandit notre horizon.
Du cœur elle endort la blessure
En s’adressant à la raison.
Oh ! ne nous laissons point surprendre
Par l’heure où rien ne peut germer.
Il n’est qu’un âge pour apprendre,
Comme il n’est qu’un temps pour semer.
TROISIÈME PARTIE : L ‘ADOLESCENCE
Mais voici venir un autre âge :
Déjà la sève au jet puissant
Éclate en gerbes de feuillage
Au front de l’arbre adolescent.
Déjà dans son nid qui chancelle
L’oiseau, que l’ombre aime à voiler,
Sent, avec sa force et son aile,
Venir le temps de s’envoler.
Déjà la vierge humble et splendide,
Cœur chaste au vent du ciel éclos,
Sort de son enfance candide
Comme Vénus sortit des flots.
Jeune arbuste de mon parterre,
Trop frêle encor pour les hivers,
A quelle brise de la terre
Ouvriras-tu tes rameaux verts ?
Jeune oiseau que le ciel convie,
Toi dont l’aile est si tendre encor,
A quelle haleine de la vie
Dois-tu confier ton essor ?
Vierge de grâces couronnée,
Tête, mes plus saintes amours,
A quel vent de la destinée,
Dis-moi, vas-tu livrer tes jours ?
Dans ton sort que je voudrais lire !
Du travail subissant les lois,
Est-ce l’aiguille, est-ce la lyre,
Qui doit frémir entre tes doigts ?
Oh ! que ce soit plutôt l’aiguille !
Borne ton vol et ton désir.
La Muse a pour vivre, ô ma fille !
Besoin d’air libre et de loisir.
Son noble sein qui nous épanche
Le lait de l’âme et des accords,
Coupe où du beau la soif s’étanche,
N’apaise point la soif du corps.
Si la tige qui nourrit l’âme
Monte et fleurit en ses vallons,
Le fruit que notre faim réclame
Ne germe point en ses sillons.
Son arbre grandit solitaire,
Rien ne croît sous son dais vainqueur :
Du laurier l’ombre est délétère
A toutes les plantes du cœur.
Amante inquiète et jalouse,
Déesse et femme tour à tour,
La Muse, à l’esprit qu’elle épouse,
Demande un exclusif amour.
Dès qu’à son culte sans mélange
Un culte étranger veut s’unir,
Fière, elle ouvre ses ailes d’ange
Et part pour ne plus revenir.
Et l’esprit que son vol délaisse,
Morne, au silence condamné,
Se vêt de lierre et de tristesse,
Ainsi qu’un temple abandonné.
Veuf et rêvant au divin hôte
Dont il a reçu les adieux,
Il sent que sa voûte est trop haute
Pour qu’elle abrite de faux dieux.
La terre, où son labeur l’enchaîne,
Lui prodigue en vain tout son miel ;
Rien ne peut adoucir sa peine
Ni lui faire oublier son ciel.
Nouvel Adam après sa chute,
Pleurant un Paradis perdu,
Sur ce sol d’angoisse et de lutte
Il jette un regard éperdu !
Ah ! se plier, superbe athlète,
Aux lois de la nécessité !
Courber sa pensée et sa tête
Au joug de la réalité !
Au char des choses de la terre
Se voir forcément atteler !
Languir exilé de sa sphère ;
Ramper, quand on pourrait voler !
Savoir que l’on porte en son âme
Un intarissable trésor,
Et soi-même étouffer sa flamme,
Tout perdre, faute d’un peu d’or !
Assister à son agonie,
Compter ses heures par ses maux,
Et voir l’arbre de son génie
S’ébrancher rameaux à rameaux !
Sacrifier plus que sa vie
Sur l’autel de la pauvreté :
Abraham de la poésie,
Immoler sa postérité !
Sentir sous des serres cruelles
Mourir le dieu ! sentir et voir
Tomber les plumes de ses ailes
Sous le froid ciseau du devoir !
Sentir au charbon du prophète
S’ouvrir ses lèvres et ses yeux ;
Se sentir créé pour le faîte
Et végéter loin des hauts lieux !
Et vivre avec de petits hommes !
Marcher dans leurs sentiers étroits !
Grand Dieu ! pour ce peu que nous sommes,
C’est trop d’une aussi lourde croix !
O ma fille ! ô ma bien-aimée,
Blonde muse de ma maison,
Au prisme de la renommée
Ferme tes yeux et ta raison !
Si Dieu, – présent funeste et triste ! –
T’illuminant d’un jour nouveau,
Du rêve étoilé de l’artiste
Embrasait ton jeune cerveau ;
Voilant les dons que Dieu te garde,
Cache à tous tes nobles penchants ;
Et, la lèvre close, sois barde
Par l’âme et non point par les chants !
Il est plus d’une voix profonde
Qui dut s’éteindre sans échos ;
Il est plus d’un cœur dont ce monde
N’a jamais connu les sanglots.
Il est, il est bien des poètes,
– Ce sont peut-être les meilleurs ! –
Qui, brisant leurs plumes muettes,
N’ont jamais écrit leurs douleurs.
Dédaigneux de se faire entendre
A des cœurs stériles ou morts,
Grands pour sentir et grands pour rendre,
Ils ont étouffé leurs accords.
Esprits qu’un souffle large anime,
Trop vrais pour un monde imposteur,
Ils n’ont point à la foule infime
Ouvert le livre de leur cœur.
En vain le dieu de l’harmonie
Dans leur sein grondait irrité,
Ils ont gardé sur leur génie
Le sceau de la virginité.
Et quand la tombe eut en ses voiles
Endormi leurs têtes de feu,
Dans le chœur sacré des étoiles
Ils sont allés chanter pour Dieu.
ENVOI À PIERRE LEGRAS
Ainsi, pendant que l’ombre amie
Plane paisible sur nos murs,
Auprès de ma fille endormie,
Je songe à ses destins futurs.
Rêveur tendre aux promptes alarmes,
Je la suis dans ses pas divers,
Et chaque goutte de mes larmes
Coule et se cristallise en vers.
Mais dans quel sein, mais dans quelle urne,
Mais dans quelle âme jeune encor,
Poète, de mon chant nocturne
Verser l’harmonieux trésor ?
Ami, que ce soit dans la vôtre,
A vous qui, vivant à l’écart,
Portez dans votre sein d’apôtre
L’amour de l’enfance et de l’Art.
Votre nature exquise et tendre
Des enfants comprend la candeur,
Et chez vous le cœur sait entendre
Les vers qui jaillissent du cœur.
Grand et simple, peu vous connaissent ;
Mais moi, qui vous suis en tout lieu,
Je sais qu’il est des lys qui naissent
Et ne fleurissent que pour Dieu.
Votre âme sereine et voilée,
A l’abri des vents importuns,
Parmi ses sœurs de la vallée,
Humble, est la plus riche en parfums.
Mais sobre au sein de l’opulence,
Mais calme et clos dans sa pudeur,
Votre esprit, amant du silence,
Ne s’ouvre que pour le Seigneur.
Oh ! gardez votre solitude,
Oh ! gardez votre obscurité,
Modeste ami, sur qui l’étude
Répand sa féconde clarté !
Dans l’infortune ou dans la joie,
Restez toujours épris du beau ;
Et pour éclairer votre voie,
Que l’Art vous serve de flambeau !
Aimez les livres et les roses,
Aimez tout ce qui fait rêver,
Les cieux, les bois, toutes ces choses
Que l’on ne saurait trop aimer !
Aimez l’homme pour sa tristesse,
Et l’oiseau pour ses joyeux chants ;
Mais plus que tout aimez sans cesse
La poésie et les enfants !
Île Bourbon, 1843.
Auguste Lacaussade, Poèmes et Paysages
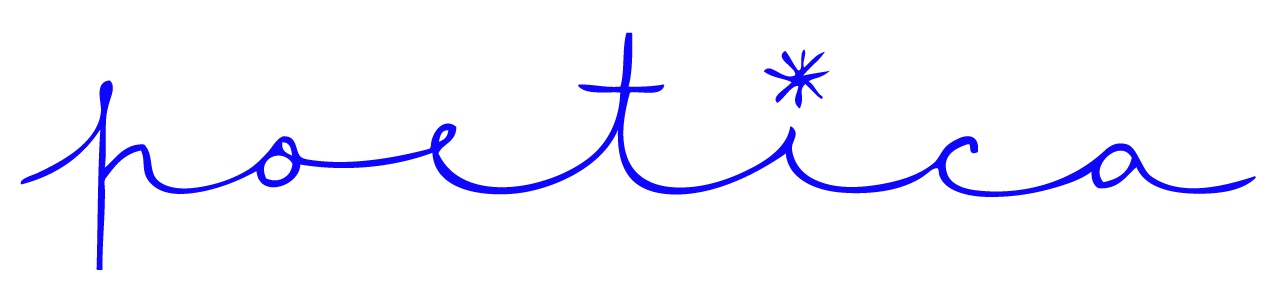

Go l’apprendre par coeur ! too easy !
très beau poème et émouvant