« Prends ma main. Voyageur, et montons sur la tour. —
Regarde tout en bas, et regarde à l’entour.
Regarde jusqu’au bout de l’horizon, regarde
Du nord au sud. Partout où ton oeil se hasarde,
Qu’il s’attache avec feu, comme l’oeil du serpent
Qui pompe du regard ce qu’il suit en rampant,
Tourne sur le donjon qu’un parapet prolonge,
D’où la vue à loisir sur tous les points se plonge
Et règne, du zénith, sur un monde mouvant
Comme l’éclair, l’oiseau, le nuage et le vent.
Que vois-tu dans la nuit, à nos pieds, dans l’espace,
Et partout où mon doigt tourne, passe et repasse ?
— Je vois un cercle noir si large et si profond,
Que je n’en aperçois ni le bout ni le fond.
Des collines, au loin, me semblent sa ceinture,
Et pourtant je ne vois nulle part la nature,
Mais partout la main d’homme et l’angle que sa main
Impose à la matière en tout travail humain.
Je vois ces angles noirs et luisants qui, dans l’ombre,
L’un sur l’autre entassés, sans ordre ni sans nombre,
Coupent des murs blanchis pareils à des tombeaux.
— Je vois fumer, brûler, éclater des flambeaux,
Brillant sur cet abîme où l’air pénètre à peine
Comme des diamants incrustés dans l’ébène.
— Un fleuve y dort sans bruit, replié dans son cours,
Comme dans un buisson la couleuvre aux cent tours.
Des ombres de palais, de dômes et d’aiguilles,
De tours et de donjons, de clochers, de bastilles,
De châteaux-forts, de kiosks et d’aigus minarets ;
De formes de remparts, de jardins, de forêts,
De spirales, d’arceaux, de parcs, de colonnades,
D’obélisques, de ponts, de portes et d’arcades,
Tout fourmille et grandit, se cramponne en montant,
Se courbe, se replie, ou se creuse ou s’étend.
— Dans un brouillard de feu je crois voir ce grand rêve.
La Tour où nous voilà dans ce cercle s’élève ;
En le traçant jadis, c’est ici, n’est-ce pas,
Que Dieu même a posé le centre du compas ?
Le vertige m’enivre, et sur mes yeux il pèse.
Vois-je une Roue ardente, ou bien une Fournaise ? »
— Oui, c’est bien une Roue ; et c’est la main de Dieu
Qui tient et fait mouvoir son invisible essieu.
Vers le but inconnu sans cesse elle s’avance.
On la nomme PARIS, le pivot de la France.
Quand la vivante Roue hésite dans ses tours,
Tout hésite et s’étonne, et recule en son cours.
Les rayons effrayés disent au cercle : « Arrête. »
Il le dit à son tour aux cercles dont la crête
S’enchâsse dans la sienne et tourne sous sa loi.
L’un le redit à l’autre ; et l’impassible roi,
Paris, l’axe immortel, Paris, l’axe du monde,
Puise ses mouvements dans sa vigueur profonde,
Les communique à tous, les imprime à chacun,
Les impose de force, et n’en reçoit aucun.
Il se meut ; tout s’ébranle, et tournoie et circule ;
Le cœur du ressort bat, et pousse la bascule ;
L’aiguille tremble et court à grands pas ; le levier
Monte et baisse en sa ligne, et n’ose dévier.
Tous marchent leur chemin, et chacun d’eux écoute
Le pas régulateur qui leur creuse la route.
Il leur faut écouter et suivre ; il le faut bien :
Car lorsqu’il arriva, dans un temps plus ancien,
Qu’un rouage isola son mouvement diurne,
Dans le bruit du travail demeura taciturne,
Et, brisa, par orgueil, sa chaîne et son ressort,
Comme un bras que l’on coupe, il fut frappé de mort.
Car Paris l’éternel de leurs efforts se joue,
Et le moyeu divin tournerait sans la roue ;
Quand même tout voudrait revenir sur ses pas,
Seul il irait ; lui seul ne s’arrêterait pas,
Et tu verrais la force et l’union ravie
Aux rayons qui partaient de son centre de vie.
C’est donc bien, voyageur, une roue en effet.
Le vertige parfois est prophétique. Il fait
Qu’une fournaise ardente éblouit ta paupière ?
C’est la fournaise aussi que tu vois. — Sa lumière
Teint de rouge les bords du ciel noir et profond ;
C’est un feu sous un dôme obscur, large et sans fond ;
Là, dans les nuits d’hiver et d’été, quand les heures
Font du bruit en sonnant sur le toit des demeures,
Parce que l’homme y dort, là veillent des Esprits,
Grands ouvriers d’une œuvre et sans nom et sans prix.
La nuit, leur lampe brûle, et, le jour, elle fume ;
Le jour, elle a fumé, le soir, elle s’allume,
Et toujours et sans cesse alimente les feux
De la Fournaise d’or que nous voyons tous deux,
Et qui, se reflétant sur la sainte coupole,
Est du globe endormi la céleste auréole.
Chacun d’eux courbe un front pâle, il prie, il écrit,
Il désespère, il pleure ; il espère, il sourit ;
Il arrache son sein et ses cheveux, s’enfonce
Dans l’énigme sans fin dont Dieu sait la réponse,
Et dont l’humanité, demandant son décret,
Tous les mille ans rejette et cherche le secret.
Chacun d’eux pousse un cri d’amour vers une idée.
L’un soutient en pleurant la croix dépossédée,
S’assied près du Sépulcre et seul, comme un banni,
Il se frappe en disant : Lamma Sabacthani ;
Dans son sang, dans ses pleurs, il baigne, il noie, il plonge
La couronne d’épine et la lance et l’éponge,
Baise le corps du Christ, le soulève, et lui dit :
« Reparais, Roi des Juifs, ainsi qu’il est prédit ;
Viens, ressuscite encore aux yeux du seul apôtre.
L’Église meurt : renais dans sa cendre et la nôtre,
Règne, et sur les débris des schismes expiés,
Renverse tes gardiens des lueurs de tes pieds. »
Rien. Le corps du Dieu ploie aux mains du dernier homme,
Prêtre pauvre et puissant pour Rome et malgré Rome.
Le cadavre adoré, de ses clous immortels
Ne laisse plus tomber de sang pour ses autels ;
Rien. Il n’ouvrira pas son oreille endormie
Aux lamentations du nouveau Jérémie,
Et le laissera seul, mais d’une habile main,
Retremper la tiare en l’alliage humain.
« Liberté ! » crie un autre, et soudain la tristesse
Comme un taureau le tue aux pieds de sa déesse,
Parce qu’ayant en vain quarante ans combattu,
Il ne peut rien construire où tout est abattu.
N’importe ! Autour de lui des travailleurs sans nombre,
Aveugles, inquiets, cherchent à travers l’ombre
Je ne sais quels chemins qu’ils ne connaissent pas,
Réglant et mesurant, sans règle et sans compas,
L’un sur l’autre semant des arbres sans racines,
Et mettant au hasard l’ordre dans les ruines.
Et, comme il est écrit que chacun porte en soi
Ce mal qui le tuera, regarde en bas, et voi.
Derrière eux s’est groupée une famille forte
Qui les ronge et du pied pile leur œuvre morte,
Écrase les débris qu’a faits la Liberté,
Y roule le niveau qu’on nomme Égalité,
Et veut les mettre en cendre, afin que pour sa tête
L’homme n’ait d’autre abri que celui qu’elle apprête ;
Et c’est un temple : un temple immense, universel,
Où l’homme n’offrira ni l’encens, ni le sel,
Ni le sang, ni le pain, ni le vin, ni l’hostie,
Mais son temps et sa vie en œuvre convertie,
Mais son amour de tous, son abnégation
De lui, de l’héritage et de la nation.
Seuls, sans père et sans fils, soumis à la parole,
L’union est son but et le travail son rôle,
Et, selon celui-là qui parle après Jésus,
Tous seront appelés et tous seront élus.
— Ainsi tout est osé ! Tu vois, pas de statue
D’homme, de roi, de Dieu, qui ne soit abattue,
Mutilée à la pierre et rayée au couteau,
Démembrée à la hache et broyée au marteau !
Or ou plomb, tout métal est plongé dans la braise,
Et jeté pour refondre en l’ardente fournaise.
Tout brûle, craque, fume et coule ; tout cela
Se tord, s’unit, se fend, tombe là, sort de là,
Cela siffle et murmure ou gémit ; cela crie,
Cela chante, cela sonne, se parle et prie ;
Cela reluit, cela flambe et glisse dans l’air,
Éclate en pluie ardente ou serpente en éclair.
Oeuvre, ouvriers, tout brûle ; au feu tout se féconde :
Salamandres partout ! — Enfer ! Éden du monde !
Paris ! principe et fin ! ombre et flambeau !…
— Je ne sais si c’est mal, tout cela ; mais c’est beau !
Mais c’est grand ! mais on sent jusqu’au fond de son âme
Qu’un monde tout nouveau se forge à cette flamme,
Ou soleil, ou comète, on sent bien qu’il sera ;
Qu’il brûle ou qu’il éclaire, on sent qu’il tournera,
Qu’il surgira brillant à travers la fumée,
Qu’il vêtira pour tous quelque forme animée,
Symbolique, imprévue et pure, on ne sait quoi,
Qui sera pour chacun le signe d’une foi,
Couvrira, devant Dieu, la terre comme un voile,
Ou de son avenir sera comme l’étoile,
Et, dans des flots d’amour et d’union, enfin
Guidera la famille humaine vers sa fin ;
Mais que peut-être aussi, brûlant, pareil au glaive
Dont le feu dessécha les pleurs dans les yeux d’Eve,
Il ira labourant le globe comme un champ,
Et semant la douleur du levant au couchant :
Rasant l’œuvre de l’homme et des temps comme l’herbe
Dont un vaste incendie emporte chaque gerbe,
En laissant le désert, qui suit son large cours
Comme un géant vainqueur, s’étendre pour toujours.
Peut-être que, partout où se verra sa flamme,
Dans tout corps s’éteindra le cœur, dans tout cœur l’âme,
Que rois et nations, se jetant à genoux,
Aux rochers ébranlés crieront : « Écrasez-nous !
Car voilà que Paris encore nous envoie
Une perdition qui brise notre voie ! »
— Que fais-tu donc, Paris, dans ton ardent foyer ?
Que jetteras-tu donc dans ton moule d’acier ?
Ton ouvrage est sans forme, et se pétrit encore
Sous la main ouvrière et le marteau sonore ;
Il s’étend, se resserre, et s’engloutit souvent
Dans le jeu des ressorts et du travail savant,
Et voilà que déjà l’impatient esclave
Se meut dans la Fournaise, et, sous les flots de lave,
Il nous montre une tête énorme, et des regards
Portant l’ombre et le jour dans leurs rayons hagards.
Je cessai de parler, car, dans le grand silence,
Le sourd mugissement du centre de la France
Monta jusqu’à la tour où nous étions placés,
Apporté par le vent des nuages glacés.
— Comme l’illusion de la raison se joue !
Je crus sentir mes pieds tourner avec la roue,
Et le feu du brasier qui montait vers les cieux
M’éblouit tellement que je fermai les yeux.
— « Ah ! dit le Voyageur, la hauteur où nous sommes
De corps et d’âme est trop pour la force des hommes.
La tête a ses faux pas comme le pied les siens ;
Vous m’avez soutenu, c’est moi qui vous soutiens,
Et je chancelle encor, n’osant plus sur la terre
Contempler votre ville et son double mystère.
Mais je crains bien pour elle et pour vous, car voilà
Quelque chose de noir, de lourd, de vaste, là,
Au plus haut point du ciel, où ne sauraient atteindre
Les feux dont l’horizon ne cesse de se teindre ;
Et je crois entrevoir ce rocher ténébreux
Qu’annoncèrent jadis les prophètes hébreux.
Lorsqu’une meule énorme, ont-ils dit… — Il me semble
La voir. — …apparaîtra sur la cité… — Je tremble
Que ce ne soit Paris. — …dont les enfants auront
Effacé Jésus-Christ du cœur comme du front…
Vous l’avez fait ! — …alors que la ville enivrée
D’elle-même, au plaisir du sang sera livrée…
Qu’en pensez-vous ? — …alors l’Ange la rayera
Du monde, et le rocher du ciel l’écrasera. »
Je souris tristement : — « Il se peut bien, lui dis-je,
Que cela nous arrive avec ou sans prodige ;
Le ciel est noir sur nous ; mais il faudrait alors
Qu’ailleurs, pour l’avenir, il fût d’autres trésors,
Et je n’en connais pas. Si la force divine
Est en ceux dont l’esprit sent, prévoit et devine,
Elle est ici. — Le Ciel la révère. — Et sur nous
L’ange exterminateur frapperait à genoux,
Et sa main, à la fois flamboyante et timide,
Tremblerait de commettre un second déicide.
Mais abaissons nos yeux, et n’allons pas chercher
Si ce que nous voyons est nuage ou rocher.
Descendons et quittons cette imposante cime
D’où l’esprit voit un rêve et le corps un abîme.
— Je ne sais d’assurés, dans le chaos du sort,
Que deux points seulement, LA SOUFFRANCE ET LA MORT.
Tous les hommes y vont avec toutes les villes.
Mais les cendres, je crois, ne sont jamais stériles.
Si celles de Paris un jour sur ton chemin
Se trouvent, pèse-les, et prends-nous dans ta main,
Et, voyant à la place une rase campagne,
Dis : « Le volcan a fait éclater sa montagne ! »
Pense au triple labeur que je t’ai révélé,
Et songe qu’au-dessus de ceux dont j’ai parlé
Il en fut de meilleurs et de plus purs encore,
Rares parmi tous ceux dont leur temps se décore,
Que la foule admirait et blâmait à moitié,
Des hommes pleins d’amour, de doute et de pitié,
Qui disaient : Je ne sais, des choses de la vie,
Dont le pouvoir ou l’or ne fut jamais l’envie,
Et qui, par dévouement, sans détourner les yeux,
Burent jusqu’à la lie un calice odieux.
— Ensuite, Voyageur, tu quitteras l’enceinte,
Tu jetteras au vent cette poussière éteinte,
Puis, levant seul ta voix dans le désert sans bruit,
Tu crieras : « Pour longtemps le monde est dans la nuit ! »
Écrit le 16 janvier 1831, à Paris
Alfred de Vigny, Poèmes antiques et modernes
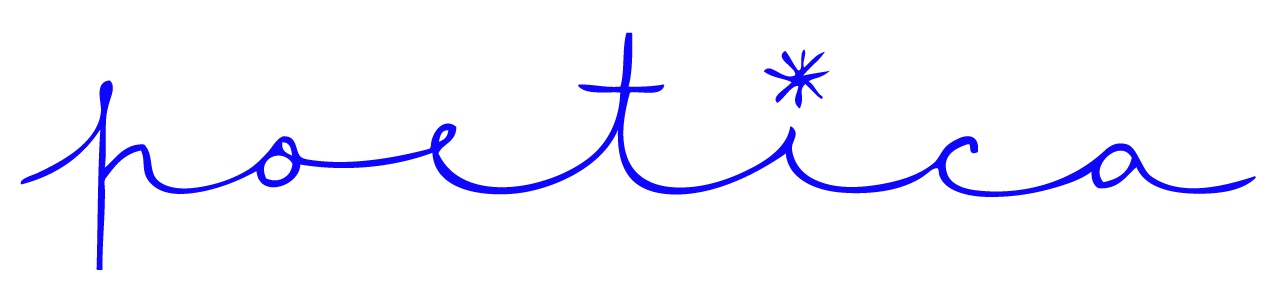

Ce poème est beaucoup trop long.
C’est trop long
J’adore ce poème.
j’aime ce poème
Paris est magique !!