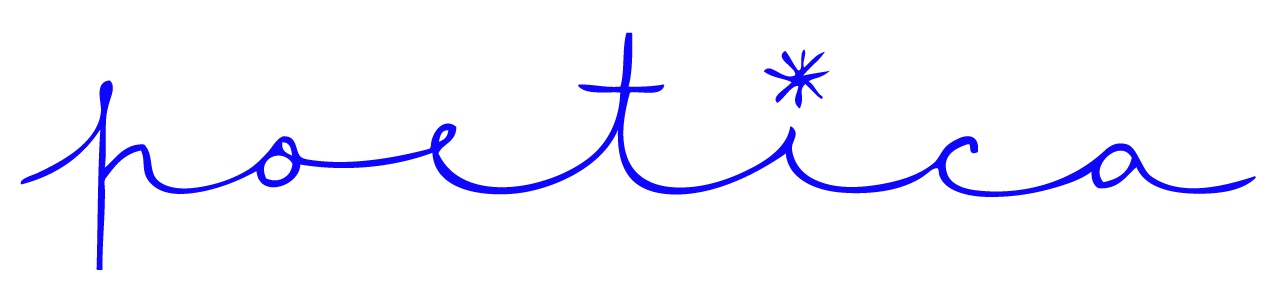« Oh ! ne vous jouez plus d’un vieillard et d’un prêtre !
« Étranger dans ces lieux, comment les reconnaître ?
« Depuis une heure au moins, cet importun bandeau
« Presse mes yeux souffrants de son épais fardeau.
« Soin stérile et cruel ! car de ces édifices
« Ils n’ont jamais tenté les sombres artifices.
« Soldats ! vous outragez le ministre et le Dieu,
« Dieu même que mes mains apportent dans ce lieu. »
Il parle ; mais en vain sa crainte les prononce :
Ces mots et d’autres cris se taisent sans réponse.
On l’entraîne toujours en des détours savants.
Tantôt crie à ses pieds le bois des ponts mouvants,
Tantôt sa voix s’éteint à de courts intervalles,
Tantôt fait retentir l’écho des vastes salles,
Dans l’escalier tournant on dirige ses pas ;
Il monte à la prison que lui seul ne voit pas,
Et, les bras étendus, le vieux prêtre timide
Tâte les murs épais du corridor humide.
On s’arrête ; il entend le bruit des pas mourir,
Sous de bruyantes clés des gonds de fer s’ouvrir.
Il descend trois degrés sur la pierre glissante,
Et, privé du secours de sa vue impuissante,
La chaleur l’avertit qu’on éclaire ces lieux ;
Enfin, de leur bandeau l’on délivre ses yeux.
Dans un étroit cachot dont les torches funèbres
Ont peine à dissiper les épaisses ténèbres,
Un vieillard expirant attendait ses secours :
Du moins ce fut ainsi qu’en un brusque discours
Ses sombres conducteurs le lui firent entendre.
Un instant, en silence, on le pria d’attendre.
« Mon prince, dit quelqu’un, le saint homme est venu,
« — Eh ! que m’importe, à moi ? » soupira l’inconnu.
Cependant, vers le lit que deux lourdes tentures
Voilent du luxe ancien de leurs pâles peintures,
Le prêtre s’avança lentement, et, sans voir
Le malade caché, se mit à son devoir.
LE PRETRE.
Écoutez-moi, mon fils.
LE MOURANT.
Hélas ! malgré ma haine,
J’écoute votre voix, c’est une voix humaine :
J’étais né pour l’entendre, et je ne sais pourquoi
Ceux qui m’ont fait du mal ont tant d’attrait pour moi.
Jamais je ne connus cette rare parole
Qu’on appelle amitié, qui, dit-on, vous console ;
Et les chants maternels qui charment vos berceaux
N’ont jamais résonné sous mes tristes arceaux ;
Et pourtant, lorsqu’un mot m’arriva moins sévère,
Il ne fut pas perdu pour mon cœur solitaire.
Mais, puisque vous m’aimez, ô vieillard inconnu,
Pourquoi jusqu’à ce jour n’êtes-vous pas venu ?
LE PRÊTRE.
Ô, qui que vous soyez ! vous que tant de mystère,
Avant le temps prescrit, sépara de la terre,
Vous n’aurez plus de fers dans l’asile des morts :
Si vous avez failli, rappelez les remords,
Versez-les dans le sein du Dieu qui vous écoute ;
Ma main du repentir vous montrera la route.
Entrevoyez le Ciel par vos maux acheté :
Je suis prêtre, et vous porte ici la liberté.
De la confession j’accomplis l’œuvre sainte ;
Le tribunal divin siège dans cette enceinte.
Répondez, le pardon déjà vous est offert ;
Dieu même…
LE MOURANT.
Il est un Dieu ? J’ai pourtant bien souffert !
LE PRÊTRE.
Vous avez moins souffert qu’il ne l’a fait lui-même.
Votre dernier soupir sera-t-il un blasphème ?
Et quel droit avez-vous de plaindre vos malheurs,
Lorsque le sang du Christ tomba dans les douleurs ?
Ô mon fils, c’est pour nous, tout ingrats que nous sommes,
Qu’il a daigné descendre aux misères des hommes ;
A la vie, en son nom, dites un mâle adieu.
LE MOURANT.
J’étais peut-être Roi.
LE PRÊTRE.
Le sauveur était Dieu ;
Mais, sans nous élever jusqu’à ce divin Maître,
Si j’osais, après lui, nommer encor le prêtre,
Je vous dirais : Et moi, pour combattre l’enfer,
J’ai resserré mon sein dans un corset de fer ;
Mon corps a revêtu l’inflexible cilice,
Où chacun de mes pas trouve un nouveau supplice.
Au cloître est un pavé que, durant quarante ans,
Ont usé chaque jour mes genoux pénitents.
Et c’est encor trop peu que de tant de souffrance
Pour acheter du Ciel l’ineffable espérance.
Au creuset douloureux il faut être épuré
Pour conquérir son rang dans le séjour sacré.
Le temps nous presse ; au nom de vos douleurs passées,
Dites-moi vos erreurs pour les voir effacées ;
Et devant cette croix où Dieu monta pour nous,
Souhaitez avec moi de tomber à genoux.
— Sur le front du vieux moine, une rougeur légère
Fit renaître une ardeur à son âge étrangère ;
Les pleurs qu’il retenait coulèrent un moment ;
Au chevet du captif il tomba pesamment ;
Et ses mains présentaient le crucifix d’ébène,
Et tremblaient en l’offrant, et le tenaient à peine.
Pour le cœur du chrétien demandant des remords,
Il murmurait tout bas la prière des morts.
Et, sur le lit, sa tête, avec douleur penchée,
Cherchait du prisonnier la figure cachée.
Un flambeau la révèle entière : ce n’est pas
Un front décoloré par un prochain trépas,
Ce n’est pas l’agonie et son dernier ravage ;
Ce qu’il voit est sans traits, et sans vie, et sans âge :
Un fantôme immobile à ses yeux est offert,
Et les feux ont relui sur un masque de fer…
Plein d’horreur à l’aspect de ce sombre mystère,
Le prêtre se souvient que, dans le monastère,
Une fois, en tremblant, on se parlait tout bas
D’un prisonnier d’État que l’on ne nommait pas ;
Qu’on racontait de lui des choses merveilleuses,
De berceau dérobé, de craintes orgueilleuses,
De royale naissance, et de droits arrachés,
Et de ses jours captifs sous un masque cachés.
Quelques pères disaient qu’à sa descente en France,
De secouer ses fers il conçut l’espérance ;
Qu’aux geôliers un instant il s’était dérobé,
Et, quoiqu’entre leurs mains aisément retombé,
L’on avait vu ses traits ; et qu’une Provençale,
Arrivée au couvent de Saint-François de Sale
Pour y prendre le voile, avait dit, en pleurant,
Qu’elle prenait la Vierge et son Fils pour garant
Que le Masque de fer avait vécu sans crime,
Et que son jugement était illégitime ;
Qu’il tenait des discours pleins de grâce et de foi,
Qu’il était jeune et beau, qu’il ressemblait au roi,
Qu’il avait dans la voix une douceur étrange,
Et que c’était un prince ou que c’était un ange.
Il se souvint encor qu’un vieux bénédictin,
S’étant acheminé vers la tour, un matin,
Pour rendre un vase d’or tombé sur son passage,
N’était pas revenu de ce triste voyage :
Sur quoi, l’abbé du lieu pour toujours défendit
Les entretiens touchant le prisonnier maudit !
« Nul ne devait sonder la récente aventure ;
« Le Ciel avait puni la coupable lecture
« Des mystères gravés sur ce vase indiscret. »
Le temps fit oublier ce dangereux secret.
Le prêtre regardait le malheureux célèbre ;
Mais ce cachot tout plein d’un appareil funèbre,
Et cette mort voilée, et ces longs cheveux blancs,
Nés captifs et jetés sur des membres tremblants,
L’arrêtèrent longtemps en un sombre silence.
Il va parler enfin ; mais, tandis qu’il balance,
L’agonisant du lit se soulève et lui dit :
« Vieillard, vous abaissez votre front interdit ;
Je n’entends plus le bruit de vos conseils frivoles ;
L’aspect de mon malheur arrête vos paroles.
Oui, regardez-moi bien, et puis dites, après,
Qu’un Dieu de l’innocent défend les intérêts ;
Des péchés tant proscrits, où toujours l’on succombe,
Aucun n’a séparé mon berceau de ma tombe ;
Seul, toujours seul, par l’âge et la douleur vaincu,
Je meurs tout chargé d’ans, et je n’ai pas vécu.
Du récit de mes maux vous êtes bien avide :
Pourquoi venir fouiller dans ma mémoire vide,
Où, stérile de jours, le temps dort effacé ?
Je n’eus point d’avenir et n’ai point de passé ;
J’ai tenté d’en avoir ; dans mes longues journées,
Je traçais sur les murs mes lugubres années ;
Mais je ne pus les suivre en leur douloureux cours.
Les murs étaient remplis, et je vivais toujours.
Tout me devint alors obscurité profonde ;
Je n’étais rien pour lui, qu’était pour moi le monde ?
Que m’importaient des temps où je ne comptais pas ?
L’heure que j’invoquais, c’est l’heure du trépas.
Écoutez, écoutez : quand je tiendrais la vie
De l’homme qui toujours tint la mienne asservie,
J’hésiterais, je crois, à le frapper des maux
Qui rongèrent mes jours, brûlèrent mon repos ;
Quand le règne inconnu d’une impuissante ivresse
Saisit mon cœur oisif d’une vague tendresse,
J’appelais le bonheur, et ces êtres amis
Qu’à mon âge brûlant un songe avait promis.
Mes larmes ont rouillé mon masque de torture ;
J’arrosais de mes pleurs ma noire nourriture ;
Je déchirais mon sein par mes gémissements ;
J’effrayais mes geôliers de mes longs hurlements ;
Des nuits, par mes soupirs, je mesurais l’espace ;
Aux hiboux des créneaux je disputais leur place,
Et, pendant aux barreaux où s’arrêtaient mes pas,
Je vivais hors des murs d’où je ne sortais pas. »
Ici tomba sa voix. Comme après le tonnerre
De tristes sons encore épouvantent la terre,
Et, dans l’antre sauvage où l’effroi l’a placé,
Retiennent en grondant le voyageur glacé,
Longtemps on entendit ses larmes retenues
Suivre encore une fois des routes bien connues ;
Les sanglots murmuraient dans ce cœur expirant.
Le vieux prêtre toujours priait en soupirant,
Lorsqu’un des noirs geôliers se pencha pour lui dire
Qu’il fallait se hâter, qu’il craignait le délire.
Un nouveau zèle alors ralluma ses discours.
« Ô mon fils ! criait-il, votre vie eut son cours ;
« Heureux, trois fois heureux, celui que Dieu corrige !
« Gardons de repousser les peines qu’il inflige :
« Voici l’heure où vos maux vous seront précieux,
« Il vous a préparé lui-même pour les cieux.
« Oubliez votre corps, ne pensez qu’à votre âme ;
« Dieu lui-même l’a dit : — L’homme né de la femme
« Ne vit que peu de temps, et c’est dans les douleurs. —
« Ce monde n’est que vide et ne vaut pas des pleurs.
« Qu’aisément de ses biens notre âme est assouvie !
« Me voilà, comme vous, au bout de cette vie ;
« J’ai passé bien des jours, et ma mémoire en deuil
« De leur peu de bonheur n’est plus que le cercueil.
« C’est à moi d’envier votre longue souffrance,
« Qui d’un monde plus beau vous donne l’espérance ;
« Les anges à vos pas ouvriront le saint lieu :
« Pourvu que vous disiez un mot à votre Dieu,
« Il sera satisfait. » Ainsi, dans sa parole,
Mêlant les saints propos du livre qui console,
Le vieux prêtre engageait le mourant à prier,
Mais en vain : tout à coup on l’entendit crier,
D’une voix qu’animait la fièvre du délire,
Ces rêves du passé : Mais enfin je respire !
Ô bords de la Provence ! ô lointain horizon !
Sable jaune où des eaux murmure le doux son !
Ma prison s’est ouverte. Oh ! que la mer est grande !
Est-il vrai qu’un vaisseau jusque là-bas se rende ?
Dieu ! qu’on doit être heureux parmi les matelots !
Que je voudrais nager dans la fraîcheur des flots !
La terre vient, nos pieds à marcher se disposent,
Sur nos mâts arrêtés les voiles se reposent.
Ah ! j’ai fui les soldats ; en vain ils m’ont cherché ;
Je suis libre, je cours, le masque est arraché ;
De l’air dans mes cheveux j’ai senti le passage,
Et le soleil un jour éclaira mon visage.
— Oh ! pourquoi fuyez-vous ? Restez sur vos gazons,
Vierges ! continuez vos pas et vos chansons ;
Pourquoi vous retirer aux cabanes prochaines ?
Le monde autant que moi déteste donc les chaînes ?
Une seule s’arrête et m’attend sans terreur :
Quoi ! du Masque de fer elle n’a pas horreur !
Non, j’ai vu la pitié sur ses lèvres si belles,
Et de ses yeux en pleurs les douces étincelles.
— Soldats ! que voulez-vous ? quel lugubre appareil !
J’ai mes droits à l’amour et ma part au soleil ;
Laissez-nous fuir ensemble. Oh ! voyez-la ! c’est elle
Avec qui je veux vivre, elle est là qui m’appelle ;
Je ne fais pas le mal ; allez, dites au roi
Qu’aucun homme jamais ne se plaindra de moi ;
Que je serai content si, près de ma compagne,
Je puis errer longtemps de montagne en montagne,
Sans jamais arrêter nos loisirs voyageurs !
Que je ne chercherai ni parents ni vengeurs ;
Et, si l’on me demande où j’ai passé ma vie,
Je saurai déguiser ma liberté ravie ;
Votre crime est bien grand, mais je le cacherai.
Ah ! laissez-moi le Ciel, je vous pardonnerai.
Non !… toujours des cachots… Je suis né votre proie…
Mais je vois mon tombeau, je m’y couche avec joie.
Car vous ne m’aurez plus, et je n’entendrai plus
Les verrous se fermer sur l’éternel reclus.
Que me veut donc cet homme avec ses habits sombres ?
Captifs morts dans ces murs, est-ce une de vos ombres ?
Il pleure. Ah ! malheureux, est-ce ta liberté ?
LE PRÊTRE.
Non, mon fils, c’est sur vous : voici l’éternité.
LE MOURANT.
A moi ? Je n’en veux pas ; j’y trouverais des chaînes.
LE PRÊTRE.
Non, vous n’y trouverez que des faveurs prochaines.
Un mot de repentir, un mot de notre foi,
Le Seigneur vous pardonne.
LE MOURANT.
Ô prêtre ! laissez-moi !
LE PRÊTRE.
Dites : « Je crois en Dieu. » La mort vous est ravie.
LE MOURANT.
Laissez en paix ma mort, on y laissa ma vie.
Et d’un dernier effort l’esclave délirant
Au mur de la prison brise son bras mourant.
« Mon Dieu ! venez vous-même au secours de cette âme ! »
Dit le prêtre, animé d’une pieuse flamme.
Au fond d’un vase d’or, ses doigts saints ont cherché
Le pain mystérieux où Dieu même est caché :
Tout se prosterne alors en un morne silence.
La clarté d’un flambeau sur le lit se balance ;
Le chevet sur deux bras s’avance supporté,
Mais en vain : le captif était en liberté.
Resté seul au cachot, durant la nuit entière,
Le vieux religieux récita la prière ;
Auprès du lit funèbre il fut toujours assis.
Quelques larmes souvent, de ses yeux obscurcis,
Interrompant sa voix, tombaient sur le saint livre.
Et, lorsque la douleur l’empêchait de poursuivre,
Sa main jetait alors l’eau du rameau bénit
Sur celui qui du ciel peut-être était banni.
Et puis, sans se lasser, il reprenait encore,
De sa voix qui tremblait dans la prison sonore,
Le dernier chant de paix ; il disait : « Ô Seigneur !
Ne brisez pas mon âme avec votre fureur ;
Ne m’enveloppez pas dans la mort de l’impie. »
Il ajoutait aussi : « Quand le méchant m’épie,
Me ferez-vous tomber, Seigneur, entre ses mains ?
C’est lui qui sous mes pas a rompu vos chemins ;
Ne me châtiez point, car mon crime est son crime.
J’ai crié vers le Ciel du plus profond abîme.
Ô mon Dieu ! tirez-moi du milieu des méchants ! »
Lorsqu’un rayon du jour eut mis fin à ses chants,
Il entendit monter vers les noires retraites,
Et des voix résonner sous les voûtes secrètes.
Un moment lui restait, il eût voulu du moins
Voir le mort qu’il pleurait sans ces cruels témoins ;
Il s’approche, en tremblant, de ce fils du mystère
Qui vivait et mourait étranger à la terre ;
Mais le Masque de fer soulevait le linceul,
Et la captivité le suivit au cercueil.
Écrit en 1821, à Vincennes.
Alfred de Vigny, Poèmes antiques et modernes