Une rose dans le haut jardin que tu désires.
Une roue dans la pure syntaxe de l’acier.
Elle est nue la montagne de brume impressionnistes.
Les gris en sont à leurs dernières balustrades.
Dans leurs blancs studios, les peintres modernes
Coupent la fleur aseptique de la racine carrée.
Sur les eaux de la Seine, un iceberg de marbre
Refroidit les fenêtres et dissipe les lierres.
L’homme, d’un pas ferme, foule les rues dallées
Et les vitres esquivent la magie du reflet.
Le Gouvernement a fermé les boutiques de parfums.
La machine éternise ses mouvements binaires.
C’est une absence de forêts, de paravents, d’entre-sourcils
Qui rôde par les terrasses des maisons antiques.
Et c’est l’air qui polit son prisme sur la mer,
C’est l’horizon qui monte comme un grand aqueduc.
Les marins ignorant le vin et la pénombre
Décapitent les sirènes sur des mers de plomb.
La Nuit, noire statue de la prudence,
Tient le miroir rond de la lune dans sa main.
Un désir nous gagne, de formes, de limites.
Voici l’homme qui voit à l’aide d’un mètre jaune.
Venus est une blanche nature-morte.
Voici que les collectionneurs de papillons s’effacent.
*
Cadaquès, sur le fléau de l’eau et de la colline,
Soulève des gradins et enfouit des coquilles.
Des flûtes de bois pacifient l’air.
Un vieux dieu sylvestre donne des fruits aux enfants.
Sans avoir pris le temps de s’endormir, les pêcheurs dorment sur la sable.
En haute mer, ils ont une rose pour boussole.
L’horizon vierge de mouchoirs blessés
Joint les masses vitrifiées du poisson et de la lune.
Une dure couronne de blanches brigantines
Ceint des fronts amers, des cheveux de sable.
Les sirènes persuasives ne nous suggestionnent pas.
Elles apparaissent au premier verre d’eau douce.
*
Ô Salvador Dali à la voix olivée !
Je ne vante pas ton imparfait pinceau adolescent,
Ni ta couleur qui courtise la couleur de ton temps.
Je chante ton angoisse, ô limité, limité éternel !
Âme hygiénique, tu vis sur des marbres nouveaux.
Tu fuis l’obscure selve des formes incroyables.
Où atteignent tes mains, ta fantaisie atteint,
Et tu jouis du sonnet de la mer dans ta fenêtre.
Aux premières bornes que l’homme rencontre,
Le monde n’est que désordre et que sourde pénombre.
Mais déjà les étoiles, cachant les paysages,
Désignent le schéma parfait de ses orbites.
Le courant du temps s’apaise et s’ordonne
Dans les formes numériques d’un siècle, et d’un autre siècle.
La Mort vaincue se réfugie en tremblant
Dans le cercle étroit de la minute présente.
En prenant ta palette, dont l’aile est trouée d’un coup de feu,
Tu demandes la lumière qui anime la coupe renversée de l’olivier.
Large lumière de Minerve, constructrice d’échafaudages,
Lumière où ni le songe, ni sa flore inexacte n’ont place.
Tu demandes la lumière antique qui reste sur le front,
Qui ne descend ni à la bouche, ni au cœur de l’homme.
Lumière que craignent les vignes poignantes de Bacchus
Et la force désordonnée qui porte l’eau courbe.
Tu as raison de banderoler la limite obscure,
Toute brillante de nuit. Et en tant que peintre,
Tu ne veux pas que ta forme soit amollie
Par le coton changeant d’un nuage imprévu.
Le poisson dans le vivier, l’oiseau dans la cage,
Tu ne veux pas les inventer dans la mer ou le vent.
Après les avoir, de tes honnêtes pupilles, bien regardés,
Tu stylises ou copies les petits corps agiles.
Tu aimes une matière définie et exacte
Où le champignon ne puisse dresser sa tente.
Tu aimes l’architecture qui contruit dans l’absent
Et tu prends le drapeau pour une simple plaisanterie.
Le compas d’acier rythme son court vers élastique.
La sphère déjà dément les îles inconnues.
La ligne droite exprime son effort vertical
Et les cristaux savants chantent leurs géométries.
*
Mais encore et toujours la rose du jardin où tu vis.
Toujours la rose, toujours ! nord et sud de nous-mêmes !
Tranquille et concentrée comme une statue aveugle,
Ignorante des efforts souterrains qu’elle cause.
Rose pure, abolissant artifices et croquis
Et nous ouvrant les ailes ténues du sourire.
(Papillon cloué qui médite son vol).
Rose de l’équilibre sans douleurs voulues. Toujours la rose !
*
Ô Salvador Sali à la voix olivée !
Je dis ce que me disent ta personne et tes tableaux.
Je ne loue pas ton imparfait pinceau adolescent,
Mais je chante la parfaite direction de tes flèches.
Je chante ton bel effort de lumières catalanes
Et ton amour pour tout ce qui explicable.
Je chante ton cœur astronomique et tendre,
Ton cœur de jeu de cartes, ton cœur sans blessure.
Je chante cette anxiété de statue que tu poursuis sans trêve,
La peur de l’émotion qui t’attend dans la rue.
Je chante la petite sirène de la mer qui te chante,
Montée sur une bicyclette de coraux et de coquillages.
Mais avant tout je chante une pensée commune
Qui nous unit aux heures obscures et dorées.
L’art, sa lumière ne gâche pas nos yeux.
C’est l’amour, l’amitié, l’escrime qui nous aveuglent.
Bien avant le tableau que, patient, tu dessines,
Bien avant le sein de Thérèse, à la peau d’insomnie,
Bien avant la boucle serrée de Mathilde l’ingrate,
Passe notre amitié peinte comme un jeu d’oie.
Que des traces dactylographiques de sang sur l’or
Rayant le cœur de la Catalogne éternelle !
Que les étoiles comme des poings sans faucon t’illuminent,
Pendant que ta peinture et que ta vie fleurissent.
Ne regarde pas la clepsydre aux ailes membraneuses,
Ni la dure faux des allégories.
Habille et déshabille toujours ton pinceau dans l’air,
Face à la mer peuplée de barques et de marins.
Federico Garcia Lorca, 1926 (traduction par Paul Eluard)
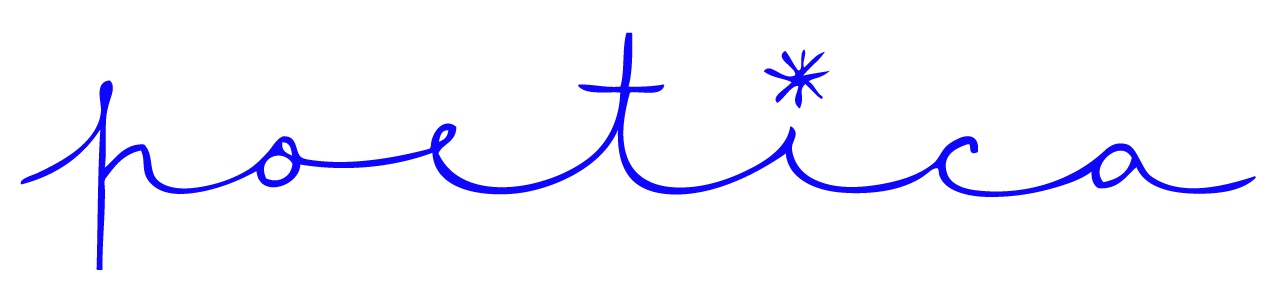

La perfection picturale sur du papier égale la perfection imagée de la poésie. C’est ça le génie !
tout simplement sublime !