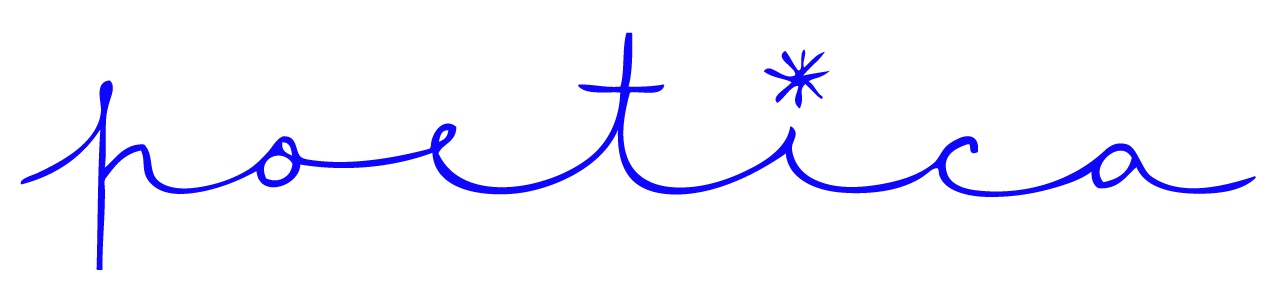Audendum est.
Ô fils du Mincius, je te salue, ô toi
Par qui le dieu des arts fut roi du peuple roi !
Et vous, à qui jadis, pour créer l’harmonie,
L’Attique, et l’onde Égée, et la belle Ionie,
Donnèrent un ciel pur, les plaisirs, la beauté,
Des mœurs simples, des lois, la paix, la liberté,
Un langage sonore, aux douceurs souveraines,
Le plus beau qui soit né sur des lèvres humaines.
Nul âge ne verra pâlir vos saints lauriers,
Car vos pas inventeurs ouvrirent les sentiers
Et du tempe des arts que la gloire environne
Vos mains ont élevé la première colonne.
À nous tous aujourd’hui, vos faibles nourrissons,
Votre exemple a dicté d’importantes leçons.
Il nous dit que nos mains, pour vous être fidèles,
Y doivent élever des colonnes nouvelles.
L’esclave imitateur naît et s’évanouit ;
La nuit vient, le corps reste, et son ombre s’enfuit.
Ce n’est qu’aux inventeurs que la vie est promise :
Nous voyons les enfans de la fière Tamise,
De toute servitude ennemis indomptés,
Mieux qu’eux, par votre exemple, à vous vaincre excités.
Osons ; de votre gloire éclatante et durable
Essayons d’épuiser la source inépuisable.
Mais inventer n’est pas, en un brusque abandon,
Blesser la vérité, le bon sens, la raison ;
Ce n’est pas entasser, sans dessein et sans forme,
Des membres ennemis en un colosse énorme ;
Ce n’est pas, élevant des poissons dans les airs,
À l’aile des vautours ouvrir le sein des mers ;
Ce n’est pas, sur le front d’une nymphe brillante,
Hérisser d’un lion la crinière sanglante :
Délires insensés ! fantômes monstrueux !
Et d’un cerveau malsain rêves tumultueux !
Ces transports déréglés, vagabonde manie,
Sont l’accès de la fièvre et non pas du génie :
D’Ormus et d’Ariman ce sont les noirs combats,
Où partout confondus, la vie et le trépas,
Les ténèbres, le jour, la forme et la matière,
Luttent sans être unis ; mais l’esprit de lumière
Fait naître en ce chaos la concorde et le jour ;
D’élémens divisés il reconnaît l’amour,
Les rappelle ; et partout, en d’heureux intervales,
Sépare et met en paix les semences rivales.
Ainsi donc, dans les arts l’inventeur est celui
Qui peint ce que chacun pût sentir comme lui,
Qui, fouillant des objets les plus sombres retraites,
Étale et fait briller leurs richesses secrètes ;
Qui, par des nœuds certains, imprévus et nouveaux,
Unissant des objets qui paraissaient rivaux,
Montre et fait adopter à la nature mère
Ce qu’elle n’a point fait, mais ce qu’elle a pu faire ;
C’est le fécond pinceau qui, sûr dans ses regards,
Retrouve un seul visage en vingt belles épars ;
Les fait renaître ensemble, et par un art suprême
Des traits de vingt beautés forme la beauté même.
La nature dicta vingt genres opposés
D’un fil léger entre eux chez les Grecs divisés.
Nul genre, s’échappant de ses bornes prescrites,
N’aurait osé d’un autre envahir les limites ;
Et Pindare à sa lyre, en un couplet bouffon,
N’aurait point de Marot associé le ton.
De ces fleuves nombreux dont l’antique Permesse
Arrosa si long-temps les cités de la Grèce,
De nos jours même, hélas ! nos aveugles vaisseaux
Ont encore oublié mille vastes rameaux.
Quand Louis et Colbert, sous les murs de Versailles,
Réparaient des beaux arts les longues funérailles ;
De Sophocle et d’Eschyle, ardens admirateurs,
De leur auguste exemple élèves inventeurs,
Des hommes immortels firent sur notre scène
Revivre aux yeux français les théàtres d’Athène.
Comme eux, instruit par eux, Voltaire offre à nos pleurs
Des grands infortunés les illustres douleurs ;
D’autres esprits divins, fouillant d’autres ruines,
Sous l’amas des débris, des ronces, dos épines,
Ont su, pleins des écrits des Grecs et des Romains,
Retrouver, parcourir leurs antiques chemins.
Mais, ô la belle palme et quel trésor de gloire
Pour celui qui, cherchant la plus noble victoire,
D’un si grand labyrinthe affrontant les hasards,
Saura guider sa muse aux immenses regards
De mille longs détours à la fois occupée,
Dans les sentiers confus d’une vaste épopée !
Lui dire d’être libre, et qu’elle n’aille pas
De Virgile et d’Homère épier tous les pas,
Par leur secours à peine à leurs pieds élevée ;
Mais, qu’auprès de leurs chars, dans un char enlevée,
Sur leurs sentiers marqués de vestiges si beaux,
Sa roue ose imprimer des vestiges nouveaux.
Quoi ! faut-il, ne s’armant que de timides voiles,
N’avoir que ces grands noms pour nord et pour étoiles,
Les côtoyer sans cesse, et n’oser un instant,
Seul et loin de tout bord intrépide et flottant,
Aller sonder les flancs du plus lointain Nérée,
Et du premier sillon fendre une onde ignorée !
Les coutumes d’alors, les sciences, les mœurs
Respirent dans les vers des antiques auteurs.
Leur siècle est en dépôt dans leurs nobles volumes.
Tout a changé pour nous, mœurs, sciences, coutumes.
Pourquoi donc nous faut-il, par un pénible soin,
Sans rien voir près de nous, voyant toujours bien loin,
Vivant dans le passé, laissant ceux qui commencent,
Sans penser écrivant d’après d’autres qui pensent,
Retraçant un tableau que nos yeux n’ont point vu,
Dire et dire cent fois ce que nous avons lu ?
De la Grèce héroïque et naissante et sauvage
Dans Homère à nos yeux vit la parfaite image.
Démocrite, Platon, Epicure, Thalès,
Ont dc loin à Virgile indiqué les secrets
D’une nature encore à leurs yeux trop. voilée.
Toricelli, Newton, Kepler et Galilée,
Plus doctes, plus heureux, dans leurs puissans efforts,
À tout nouveau Virgile ont ouvert des trésors.
Tons les arts sont unis : les sciences humaines
N’ont pu de leur empire étendre les domaines,
Sans agrandir aussi la carrière (les vers.
Quel long travail pour eux a conquis l’univers !
Aux regards de Buffon, sans voile, sans obstacles,
La terre ouvrant son sein, ses ressorts, ses miracles,
Ses germes, ses coteaux, dépouille de Thétis :
Les nuages épais, sur elle appesantis,
De ses noires vapeurs nourrissant leur tonnerre,
Et l’hiver ennemi pour envahir la terre
Roi des antres dut Nord : et, de glaces armés,
Ses pas usurpateurs sur nos monts imprimés ;
Et l’œil perçant du verre en la vaste étendue,
Allant chercher ces feux qui fuyaient notre vue.
Aux changemens prédits, immuables, fixés,
Que d’une plume d’or Bailly nous a tracés ;
Aux lois de Cassini les comètes fidèles ;
L’aimant, de nos vaisseaux seul dirigeant les ailes,
Une Cibèle neuve et cent mondes divers,
Aux yeux de nos Jasons sortis du, sein des mers.
Quel amas de tableaux, de sublimes images,
Nait de ces grands objets réservés à nos âges !
Sous ces bois étrangers qui couronnent ces monts,
Aux vallons de Cusco, dans ces antres profonds,
Si chers à la fortune et plus chers au génie,
Germent des mines d’or, de gloire et d’harmonie.
Pensez-vous, si Virgile, ou l’Aveugle divin,
Renaissaient aujourd’hui, que leur savante main
Négligeât de saisir ces fécondes richesses,
De notre Pinde auguste éclatantes largesses ?
Nous en verrions briller leurs sublimes écrits :
Et ces mêmes objets que vos doctes mépris
Accueillent aujourd’hui d’un front dur et sévère,
Alors à vos regards auraient seuls droit de plaire ;
Alors, dans l’avenir, votre inflexible humeur
Aurait soin de défendre à tout jeune rimeur
D’oser sortir jamais de ce cercle d’images
Que vos yeux auraient vu tracé dans leurs ouvrages.
Mais qui jamais a su, dans des vers séduisans,
Sous des dehors plus vrais peindre l’esprit aux sens !
Mais quelle voix jamais, d’une plus pure flamme,
Et chatouilla l’oreille et pénétra dans l’aine !
Mais leurs mœurs et leurs lois, et mille autres hasards,
Rendaient leur siècle heureux plus propice aux beaux-arts.
Eh bien ! l’ame est partout ; la pensée a des ailes.
Volons, volons chez eux retrouver leurs modèles,
Voyageons dans leur âge, où libre, sans détour,
Chaque homme ose être un homme et penser au grand jour.
Au tribunal de Mars, sur la pourpre romaine,
Là du grand Cicéron la vertueuse haine
Écrase Céthégus, Catilina, Verrès ;
Là tonne Démosthène ; ici, de Périclès
La voix, l’ardente voix, de tous les cœurs maîtresse,
Frappe, foudroie, agite, épouvante la Grèce :
Allons voir la grandeur et l’éclat de leurs jeux.
Ciel ! la mer appelée en un bassin pompeux !
Deux flottes parcourant cette enceinte profonde,.
Combattant sous les yeux des conquérons du monde.
Ô terre de Pélops ! avec le monde entier
Allons voir d’Épidaure un agile coursier,
Couronné dans les champs de Némée et d’Elide ;
Allons voir au théâtre, aux accens d’Euripide,
D’une sainte folie un peuple furieux
Chanter : Amour, tyran des hommes et des dieux.
Puis, ivres des transports qui nous viennent surprendre,
Parmi nous, dans nos vers, revenons les répandre ;
Changeons en notre miel leurs plus antiques fleurs ;
Pour peindre notre idée, empruntons leurs couleurs ;
Allumons nos flambeaux à leurs feux poétiques ;
Sur des pensers nouveaux faisons des vers antiques.
Direz-vous qu’un objet, né sur leur Hélicon,
À seul de nous charmer pu recevoir le don ?
Que leurs fables, leurs dieux, ces mensonges futiles,
Des Muses noble ouvrage, aux Muses sont utiles ?
Que nos travaux savons, nos calculs studieux,
Qui subjuguent l’esprit et répugnent aux yeux,
Que l’on croit malgré soi, sont pénibles, austères,
Et moins grands, moins pompeux que leurs belles chimères ?
Voilà ce que Traités, Préfaces, longs discours,
Prose, rime, partout nous disent tous les jours.
Mais enfin, dites-moi, si d’une œuvre immortelle
La nature est en nous la source et le modèle ;
Pouvez-vous le penser que tout cet univers,
Et cet ordre éternel, ces mouvemens divers,
L’immense vérité, la nature elle-même,
Soit moins grande en effet que ce brillant systême
Qu’ils nommaient la nature, et dont d’heureux efforts
Disposaient avec art les fragiles ressorts ?
Mais quoi ! ces vérités sont au loin reculées,
Dans un langage obscur saintement recelées :
Le peuple les ignore. Ô Muses, Ô Phébus !
C’est là, c’est là sans doute un aiguillon de plus.
L’auguste poésie, éclatante interprète,
Se couvrira de gloire en forçant leur retraite.
Cette reine des cœurs, à la touchante voix,
À le droit, en tous lieux, de nous dicter son choix.
Sûre de voir partout, introduite par elle,
Applaudir à grands cris une beauté nouvelle,
Et les objets nouveaux que sa voix a tentés
Partout de bouche en bouche après elle chantés.
Elle porte, à travers leurs nuages plus sombres,
Des rayons lumineux qui dissipent leurs ombres ;
Et rit quand, dans son vide, un auteur oppressé
Se plaint qu’on a tout dit et que tout est pensé.
Seule, et la lyre en main, et de fleurs couronnée,
De doux ravissemens partout accompagnée,
Aux lieux les plus déserts, ses pas, ses jeunes pas,
Trouvent mille trésors qu’on ne soupçonnait pas.
Sur l’aride buisson que son regard se pose,.
Le buisson à ses yeux rit et jette une rose.
Elle sait ne point voir, dans son juste dédain,
Les fleurs qui trop souvent, courant de main en main,
Ont perdu tout l’éclat de leurs fraîcheurs vermeilles ;
Elle sait même encore, ô charmantes merveilles !
Sous ses doigts délicats réparer et cueillir
Celles qu’une autre main n’avait su que flétrir ;
Elle seule connaît ces extases choisies,
D’un esprit tout de feu mobiles fantaisies,
Ces rêves d’un moment, belles illusions,
D’un monde imaginaire aimables visions,
Qui ne frappent jamais, trop subtile lumière,
Des terrestres esprits l’œil épais et vulgaire.
Seule, de mots heureux, faciles, transparens,
Elle sait revêtir ces fantômes errans :
Ainsi des hauts sapins de la Finlande humide,
De l’ambre, enfant du ciel, distille l’or fluide ;
Et sa chute souvent rencontre dans les airs
Quelque insecte volant qu’il porte au fond des mers ;
De la Baltique enfin les vagues orageuses
Roulent et vont jeter ces larmes précieuses,
Où la fière Vistule, en de nobles coteaux,
Et le froid Niémen expirent dans ses eaux.
Là lès arts vont cueillir cette merveille utile,
Tombe odorante où vit l’insecte volatile,
Dans cet or diaphane il est lui-même encor,
On dirait qu’il respire et va prendre l’essor.
Qui que tu sois enfin ; ô toi, jeune poète,
Travaille ; ose achever cette illustre conquête.
De preuves, de raisons, qu’est-il encor besoin ?
Travaille. Un grand exemple est un puissant témoin.
Montre ce qu’on peut faire, en le faisant toi-même ;
Si pour toi la retraite est un bonheur suprême,
Si chaque jour les vers de ces maîtres fameux
Font bouillonner ton sang et dressent tes cheveux ;
Si tu sens chaque jour, animé de leur ame,
Ce besoin de créer, ces transports, cette flamme,
Travaille. À nos censeurs, c’est à toi de montrer
Tous ces trésors nouveaux qu’ils veulent ignorer.
Il faudra bien les voir, il faudra bien se taire,
Quand ils verront enfin cette gloire étrangère
De rayons inconnus ceindre ton front brillant.
Aux antres de Paros le bloc étincelant
N’est aux vulgaires yeux qu’une pierre insensible.
Mais le docte ciseau, dans son sein invisible,
Voit, suit, trouve la vie, et l’ame, et tous ses traits.
Tout l’Olympe respire en ses détours secrets.
Là vivent de Vénus les beautés souveraines ;
Là des muscles nerveux, là de sanglantes veines
Serpentent ; là des flancs invaincus aux travaux
Pour soulager Atlas des célestes fardeaux.
Aux volontés du fer leur enveloppe énorme
Cède, s’amollit, tombe ; et de ce bloc informe
Jaillissent, éclatans, des dieux pour nos autels
C’est Apollon lui-même, honneur des immortels ;
C’est Alcide vainqueur des monstres de Némée ;
C’est du vieillard troyen la mort envenimée ;
C’est des Hébreux errans le chef, le défenseur :
Dieu tout entier habite en ce marbre penseur.
Ciel ! n’entendez-vous pas de sa bouche profonde
Éclater cette voix créatrice du monde.
Ô qu’ainsi parmi nous des esprits inventeurs
De Virgile et d’Homère atteignent les hauteurs !
Sachent dans la mémoire avoir comme eux un temple,
Et sans suivre leurs pas imiter leur exemple ;
Faire, en s’éloignant d’eux, avec un soin jaloux,
Ce qu’eux-même ils feraient s’ils vivaient parmi nous !
Que la nature seule, en ses vastes miracles,
Soit leur fable et leurs dieux, et ses lois leurs oracles ;
Que leurs vers, de Thétis respectant le sommeil,
N’aillent plus dans ses flots rallumer le soleil ;
De la cour d’Apollon que l’erreur soit bannie,
Et qu’enfin Calliope, élève d’Uranie,
Montant sa lyre d’or sur un plus noble ton,
En langage des dieux fasse parler Newton !
Oh ! si je puis, un jour !… Mais, quel est ce murmure,
Quelle nouvelle attaque et plus forte et plus dure ?
Ô langue des Français ! est-il vrai que ton sort
Est de ramper toujours et que toi seule as tort ?
Ou si d’un faible esprit l’indolente paresse
Veut rejeter sur toi sa honte et sa faiblesse ?
Il n’est sot traducteur de sa richesse enflé,
Sot auteur d’un poème, ou d’un discours sifflé,
Ou d’un recueil ombré de chansons à la glace,
Qui ne vous avertisse, en sa fière préface’,
Que si son style épais vous fatigue d’abord,
Si sa prose vous pèse et bientôt vous endort ;
Si son vers est gêné, sans feu, sans harmonie,
Il n’en est point coupable ; il n’est pas sans génie,
Il a tous les talens qui font les grands succès :
Mais enfin, malgré lui, ce langage français,
Si faible en ses couleurs, si froid et si timide,
L’a contraint d’être lourd, gauche, plat, insipide.
Mais serait-ce Le Brun, Racine, Despréaux,
Qui l’accusent ainsi d’abuser leurs travaux ?
Est-ce à Rousseau, Buffon, qu’il résiste infidelle ?
Est-ce pour Montesquieu, qu’impuissant et rebelle,.
Il fuit ? Ne sait-il pas, se reposant sur eux,
Doux, rapide, abondant, magnifique, nerveux,
Creusant dans les détours de ces aines profondes,
S’y teindre, s’y tremper de leurs couleurs fécondes ?
Un rimeur voit partout un nuage ; et jamais,
D’un coup d’œil ferme et grand, n’a saisi les objets ;
La langue se refuse à ses demi-pensées,
De sang-froid, pas à pas, avec peine amassées :
Il se dépite alors, et restant en chemin,
Il se plaint qu’elle échappe et glisse de sa main.
Celui qu’un vrai démon presse, enflamme, domine,
Ignore un tel supplice : il pense, il imagine ;
Un langage imprévu dans son ame produit,
Naît avec sa pensée, et l’embrasse et la suit ;
Les images, les mots que le génie inspire,
Où l’univers entier vit, se meut et respire,
Source vaste et sublime et qu’on ne peut tarir,
En foule en son cerveau se hâtent de courir.
D’eux-même ils vont chercher un nœud qui les rassemble :
Tout s’allie et se forme, et tout va naître ensemble.
Sous l’insecte vengeur envoyé par Junon,
Telle Io tourmentée, en l’ardente saison,
Traverse en vain les bois et la longue campagne,
Et le fleuve bruyant qui presse la montagne ;
Tel le bouillant poète, en ses transports brûlans,
Le front échevelé, les yeux étincelans,
S’agite, se débat ; cherche en d’épais bocages
S’il pourra de sa tête apaiser les orages,
Et secouer le dieu qui fatigue son sein.
De sa bouche à grands flots ce dieu dont il est plein,
Bientôt en vers nombreux s’exhale et se déchaîne :
Leur sublime torrent roule, saisit, entraîne.
Les tours impétueux, inattendus, nouveaux,
L’expression de flamme aux magiques tableaux,
Qu’a trempés la nature en ses couleurs fertiles ;
Les nombres tour à tour turbulens ou faciles :
Tout porte au fond du cœur le tumulte et la paix,
Dans la mémoire au loin tout s’imprime à jamais.
C’est ainsi que Minerve, en un instant formée,
Du front de Jupiter s’élance toute armée,
Secouant et le glaive et le casque guerrier,
Et l’horrible Gorgone à l’aspect meurtrier.
Des Toscans, je le sais, la langue est séduisante ;
Cire molle à tout feindre habile et complaisante,
Qui prend d’heureux contours sous les plus faibles mains.
Quand le Nord, s’épuisant de barbares essaims,
Vint, par une conquête en malheurs plus féconde,
Venger sur les Romains l’esclavage du monde,
De leurs affreux accens la farouche âpreté
Du latin en tous lieux souilla la pureté :
On vit de ce mélange étranger et sauvage
Naitre des langues sœurs, que le temps et l’usage,
Par des sentiers divers guidant diversement,
D’une lime insensible ont poli lentement,
Sans pouvoir en entier, malgré tous leurs prodiges,
De la rouille barbare effacer les vestiges.
De là du Castillan la pompe et la fierté,
Teint encor des couleurs du langage indompté,
Qu’au Tage transplantaient les fureurs musulmanes.
La grâce et la douceur sur les lèvres toscanes
Fixèrent leur empire ; et la Seine à la fois
De grâce et de fierté sut composer sa voix.
Mais ce langage, armé d’obstacles indociles,
Lutte et ne veut plier que sous des mains habiles.
Est-ce un mal ? Eh ! plutôt, rendon, rendons grâces aux dieux ;
Un faux éclat long-temps ne peut tromper nos yeux,
Et notre langue même à tout esprit vulgaire
De nos vers dédaigneux fermant le sanctuaire,
L’avertit dès l’abord que, s’il y veut monter,
Il faut savoir tout craindre et savoir tout tenter ;
Et, recueillant affronts ou gloire sans mélange,
S’élever jusqu’au faîte ou ramper dans la fange.
André Chénier