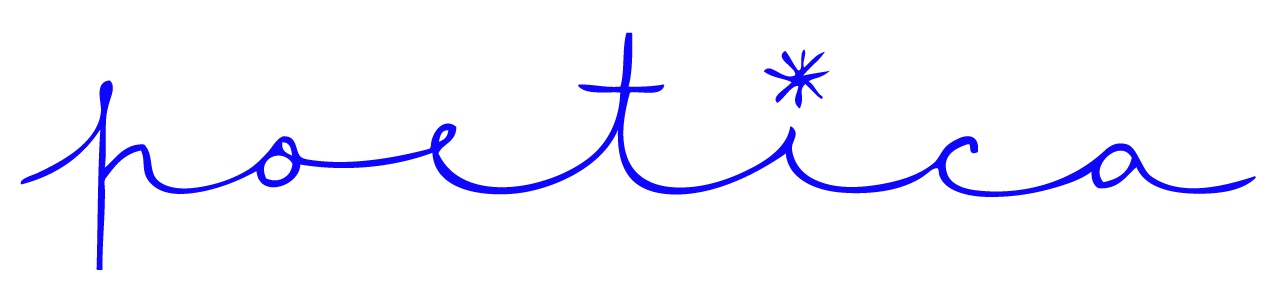« Dieu, dont l’arc est d’argent, dieu de Claros, écoute,
» Ô Sminthée-Apollon, je périrai sans doute,
» Si tu ne sers de guide à cet aveugle errant. »
C’est ainsi qu’achevait l’aveugle en soupirant,
Et près des bois marchait, faible, et sur une pierre
S’asseyait. Trois pasteurs, enfans de cette terre,
Le suivaient, accourus aux abois turbulens
Des Molosses, gardiens de leurs troupeaux bêlans.
Ils avaient, retenant leur fureur indiscrète,
Protégé du vieillard la faiblesse inquiète ;
Ils l’écoutaient de loin ; et s’approchant de lui :
« Quel est ce vieillard blanc, aveugle et sans appui ?
» Serait-ce un habitant de l’empire céleste ?
» Ses traits sont grands et fiers ; de sa ceinture agreste
» Pend une lyre informe, et les sons de sa voix
» Émeuvent l’air et l’onde et le ciel et les bois. »
Mais il entend leurs pas, prête l’oreille, espère,
Se trouble, et tend déjà les mains à la prière.
« Ne crains point, disent-ils, malheureux étranger ;
» (Si plutôt sous un corps terrestre et passager
» Tu n’es point quelque dieu protecteur de la Grèce,
» Tant une grâce auguste ennoblit ta vieillesse !)
» Si tu n’es qu’un mortel, vieillard infortuné,
» Les humains près de qui les flots t’ont amené,
» Aux mortels malheureux n’apportent point d’injures.
» Les destins n’ont jamais de faveurs qui soient pures.
» Ta voix noble et touchante est un bienfait des dieux ;
» Mais aux clartés du jour ils ont fermé tes yeux.
» — Enfans, car votre voix est enfantine et tendre,
» vos discours sont prudens, plus qu’on n’eût dû l’attendre ;
» Mais toujours soupçonneux, l’indigent étranger
» Croit qu’on rit de ses maux et qu’on veut l’outrager.
» Ne me comparez point à la troupe immortelle :
» Ces rides, ces cheveux, cette nuit éternelle,
» Voyez ; est-ce le front d’un habitant des cieux ?
» Je ne suis qu’un mortel, un des plus malheureux
» Si vous en savez un pauvre, errant, misérable,
» C’est à celui-là seul que je suis comparable ;
» Et pourtant je n’ai point, comme fit Thomyris,
» Des chansons à Phœbus voulu ravir le prix ;
» Ni, livré comme OEdipe à la noire Euménide,
» Je n’ai puni sur moi l’inceste parricide ;
» Mais les dieux tout-puissans gardaient à mon déclin
» Les ténèbres, l’exil, l’indigence et la faim.
» Prends ; et puisse bientôt changer ta destinée,
» Disent-ils. » Et tirant ce que, pour leur journée,
Tient la peau d’une chèvre aux crins noirs et luisans,
Ils versent à l’envi, sur ses genoux pesans,
Le pain de pur froment, les olives huileuses,
Le fromage et l’amande, et les figues mielleuses,
Et du pain à son chien entre ses pieds gissant,
Tout hors d’haleine encore, humide et languissant ;
Qui malgré les rameurs, se lançant à la nage,
L’avait loin du vaisseau rejoint sur le rivage..
« Le sort, dit le vieillard, n’est pas toujours de fer.
» Je vous salue, enfans venus de Jupiter.
» Heureux sont les parens qui tels vous firent naître !
» Mais venez, que mes mains cherchent à vous connaît ;
» Je crois avoir des yeux. Vous êtes beaux tous trois.
» Vos visages sont doux, car douce est votre, voix.
» Qu’aimable est la vertu que la grâce environne !
» Croissez, comme j’ai vu ce palmier de Latone,
» Alors qu’ayant des yeux je traversai les flots ;
» Car jadis, abordant à la sainte Délos,
» Je vis près d’Apollon, à son autel de pierre,
» Un palmier, don du ciel, merveille de la terre.
» Vous croîtrez, comme lui, grands, féconds, révérés.
»’Puisque les malheureux sont par vous honorés.
» Le plus âgé de vous aura vu treize années :
» À peine, mes enfans, vos mères étaient nées,
» Que j’étais presque vieux. Assieds-toi près de moi,
» Toi, le plus grand de tous ; je me confie à toi.
» Prends soin du vieil aveugle.-O sage magnanime !
» Comment, et d’où viens-tu ? car l’oncle maritime
» Mugit de toutes parts sur nos bords orageux.
» — Des marchands de Cymé m’avaient pris avec eux.
» J’allais voir, m’éloignant des rives de Carie,
» Si la Grèce pour moi n’aurait point de patrie,
» Et des dieux moins jaloux, et de moins tristes jours ;
» Car jusques à la mort nous espérons toujours.
» Mais pauvre, et n’ayant rien pour payer mon passage,
» Ils m’ont, je ne sais où, jeté sur le rivage.
» — Harmonieux vieillard, tu n’as donc point chanté ?
» Quelques sons de ta voix auraient tout acheté.
» — Enfans, du rossignol la voix pure et légère
» N’a jamais apaisé le vautour sanguinaire,
» Et les riches grossiers, avares, insolens,
» N’ont pas une ame ouverte à sentir les talens.
» Guidé par ce bâton, sur l’arène glissante,
» Seul, en silence, au bord de l’onde mugissante,
» J’allais ; et j’écoutais le bêlement lointain
» Da troupeaux agitant leurs Sonnettes d’airain.
» Puis j’ai pris cette lyre, et les cordes mobiles
» Ont encor résonné sous mes vieux doigts débiles.
» Je voulais deS grands dieux implorer la bonté,
» Et surtout Jupiter, dieu d’hospitalité :
» Lorsque d’énormes chiens, à la voix formidable,
» Sont venus m’assaillir ; et j’étais misérable,
» Si vous (car c’était vous) avant qu’ils m’eussent pris
» N’eussiez armé pour moi les pierres et les cris.
» — Mon père, il est donc vrai : tout est devenu pire ?
» Car jadis, aux accens d’une éloquente lyre,
» Les tigres et les loups, vaincus, humiliés,
» D’un chanteur comme toi vinrent baiser les pieds.
» — Les barbares ! J’étais assis près de la poupe.
» Aveugle vagabond, dit l’insolente troupe,
» Chante ; si ton esprit n’est point comme tes yeux,
» Amuse notre ennui ; tu rendras grâce aux dieux.
» J’ai fait taire mon cœur qui voulait les confondre ;
» Ma bouche ne s’est point ouverte à leur répondre.
» Ils n’ont pas entendu ma voix, et sous ma main
» J’ai retenu le dieu courroucé dans mon sein.
» Cymé, puisque tes fils dédaignent Mnémosyne,
» Puisqu’ils ont fait outrage à la muse divine,
» Que leur vie et leur mort s’éteigne dans l’oubli ;
» Que ton nom dans la nuit demeure enseveli.
» — Viens, suis-nous à la ville ; elle est toute voisine,
» Et chérit les amis de la muse divine.
» Un siége aux cloux d’argent te place à nos festins ;
» Et là les mets choisis, le miel et les bons vins,
» Sous la colonne où pend une lyre d’ivoire,
» Te feront de tes maux oublier la mémoire.
» Et si, dans le chemin, rhapsode ingénieux,
» Tu veux nous accorder tes chants dignes des cieux,
» Nous dirons qu’Apollon, pour charmer les oreilles,
» T’a lui-même dicté de si douces merveilles.
» — Oui, je le veux ; marchons. Mais où m’entraînez-vous ?
» Enfans du vieil aveugle, en quel lieu sommes-nous
» — Sicos est l’île heureuse où nous vivons, mon père.
» — Salut, belle Sicos, deux fois hospitalière !
» Car sur ses bords heureux je suis déjà venu,
» Amis, je la connais. Vos pères m’ont connu :
» Ils croissaient comme vous ; mes yeux s’ouvraient encore
» Au Soleil, au printemps, aux roses de l’aurore ;
» J’étais jeune et vaillant. Aux danses des guerriers,
» À la course, aux combats, j’ai paru des premiers.
» J’ai vu Corinthe, Argos, et Crète et les cent villes,
» Et du fleuve Égyptus les rivages fertiles ;
» ; Mais la terre et la mer, et l’âge et les malheurs,
» Ont épuisé ce corps fatigué de douleurs.
» La voix me reste. Ainsi la cigale innocente,
» Sur un arbuste assise, et se console et chante.
» Commençons par les dieux : Souverain Jupiter ;
» Soleil, qui vois, entends, connais tout ; et toi, mer,
» Fleuves, terre, et noirs dieux des vengeances trop lentes,
» Salut ! Venez à moi de l’Olympe habitantes,
» Muses ; vous savez tout, vous déesses ; et nous,
» Mortels, ne savons rien qui ne vienne de vous. »
Il poursuit ; et déjà les antiques ombrages
Mollement en cadence inclinaient leurs feuillages ;
Et pâtres oubliant leur troupeau délaissé,
Et voyageurs quittant leur chemin commencé,
Couraient ; il les entend, près de son jeune guide,
L’un sur l’autre pressés tendre une oreille avide ;
Et nymphes et sylvains sortaient pour l’admirer,
Et l’écoutaient en foule, et n’osaient respirer ;
Car, en de longs détours de chansons vagabondes,
Il enchaînait de tout les semences fécondes ;
Les principes du feu, les eaux, la terre et l’air,
Les fleuves descendus du sein de Jupiter,
Les oracles, les arts, les cités fraternelles,
Et depuis le chaos les amours immortelles.
D’abord le Roi divin, et l’Olympe et les Cieux
Et le Monde, ébranlés d’un signe de ses yeux ;
Et les dieux partagés en une immense guerre,
Et le sang plus qu’humain venant rougir la terré,
Et les rois assemblés, et Sous les pieds guerriers,
Une nuit de poussière, : et les chars meurtriers ;
Et les héros armés, brillans dans les campagnes,
Comme un vaste incendie aux cimes des montagnes.
Les coursiers hérissant leur crinière à longs flots,
Et d’une voix humaine excitant les héros.
De là, portant ses pas dans les paisibles villes,
Les lois, les orateurs, les récoltes fertiles.
Mais bientôt de soldats les remparts entourés,
Les victimes tombant dans les parvis sacrés,
Et les assauts, mortels aux épouses plaintives,
Et les mères en deuil, et les filles captives ;
Puis aussi les moissons joyeuses, les troupeaux
Bêlans ou mugissans, les rustiques pipeaux,
Les chansons, les festins, les vendanges bruyantes,
Et la flûte et la lyre, et les notes dansantes ;
Puis, déchaînant les vents à soulever les mers,
Il perdait les nochers sur les gouffres amers.
De là, dans le sein frais d’une roche azurée,
En foule il appelait les filles de Nérée,
Qui bientôt, à des cris, s’élevant sur les eaux,
Aux rivages troyens parcouraient des vaisseaux ;
Puis il ouvrait du Styx la rive criminelle,
Et puis les demi-dieux et les champs d’Asphodèle,
Et la foule des morts ; vieillards seuls et souffrans,
Jeunes gens emportés aux yeux de leurs parens,
Enfans dont au berceau la vie est terminée,
Vierges dont le trépas suspendit l’hyménée.
Mais ô bois, ô ruisseaux, ô monts, ô durs cailloux,
Quels doux frémissemens vous agitèrent tous
Quand bientôt à Lemnos, sur l’enclume divine,
Il forgeait cette trame irrésistible et fine,
Autant que d’Arachné les piéges inconnus,
Et dans ce fer mobile emprisonnait Vénus !
Et quand il revêtit d’une pierre soudaine
La fière Niobé, cette mère thébaine,
Et quand il répétait en accens de douleurs’
De la triste Aédon l’imprudence et les pleurs,
Qui, d’un fils méconnu marâtre involontaire,
Vola, doux rossignol, sous le bois solitaire ;
Ensuite, avec le vin, il versait aux héros
Le puissant Népenthès, oubli de tous les maux ;
Il cueillait le Moly, fleur qui rend l’homme sage ;
Du paisible Lotos il mêlait le breuvage.
Les mortels oubliaient, à ce philtre charmés,
Et la douce patrie et les parens aimés ;
Enfin, l’Ossa, l’Olympe et les bois du Pénée
Voyaient ensanglanter les banquets d’hyménée,
Quand Thésée, au milieu de la joie et du vin,
La nuit où son ami reçut à son festin
Le peuple monstrueux des enfans de la nue,
Fut contraint d’arracher l’épouse demi-nue
Au bras ivre et nerveux du sauvage Eurytus.
Soudain, le glaive en main, l’ardent Pirithoüs
« Attends ; il faut ici que mon affront s’expie,
» Traître ! » Mais, avant lui, sur le centaure impie,
Dryas a fait tomber, avec tous ses rameaux,
Un long arbre de fer hérissé de flambeaux.
L’insolent quadrupède en vain s’écrie, il tombe ;
Et son pied bat le sol qui doit être sa tombe.
Sous l’effort de Nessus, la table du repas
Roule, écrase Cymèle, Évagre, Périphas.
Pirithoüs égorge Antimaque, et Pétrée,
Et Cyllare aux pieds blancS, et le noir Macarée,
Qui de trois fiers lions, dépouillés par sa main,
Couvrait ses quatre flancs, armait son double sein.
Courbé, levant un roc choisi pour leur vengeance,
Tout-à-coup, sous l’airain d’un vase antique, immense,
L’imprudent Bianor, par Hercule surpris,
Sent de sa tête énorme éclater les débris.
Hercule et la massue entassent en trophée
Clanis, Démoléon, Lycotas, et Riphée
Qui portait sur ses crins, de taches, colorés,
L’héréditaire éclat des nuages dorés.
Mais d’un double combat Eurynome est avide ;
Car ses pieds, agités en un cercle rapide,
Battent à coups pressés l’armure de Nestor ;
Le quadrupède Hélops fuit l’agile Crantor ;
Le bras levé l’atteint ; Eurynome l’arrête.
D’un érable noueux il va fendre sa tête :
Lorsque le fils d’Égée, invincible, sanglant,
L’aperçoit ; à l’autel prend un chêne brûlant ;
Sur sa croupe indomptée, avec un cri terrible,
S’élance ; va saisir sa chevelure horrible,
L’entraîne, et quand sa bouche ouverte avec effort,
Crie ; il y plonge ensemble et la flamme et la mort.
L’autel est dépouillé. Tous vont s’armer de flamme,
Et le bois porte au loin les hurlernens de femme,
L’ongle frappant la terre, et les guerriers meurtris,
Et les vases brisés, et l’injure, et les cris.
Ainsi le grand vieillard, en images hardies,
Déployait, le tissu des saintes mélodies.
Les trois enfans, émus à son auguste aspect,
Admiraient, d’un regard de joie et de respect,
De sa bouche abonder les paroles divines,
Comme en hiver la neige aux sommets des collines.
E partout accourus, dansant sur son chemin,
Hommes, femmes, enfans, les rameaux à la main,
Et vierges et guerriers, jeunes fleurs de la ville,
Chantaient : « Viens dans nos murs, viens habiter notre île ;
» Viens, prophète éloquent, aveugle harmonieux,
» Convive du nectar, disciple aimé des dieux ;
» Des jeux, tous les cinq ans, rendront saint et prospère
» Le jour où nous avons reçu le grand Homère. »
André Chénier, Idylles