I
Un lourd soleil tombait d’aplomb sur le lavoir ;
Les canards engourdis s’endormaient dans la vase,
Et l’air brûlait si fort qu’on s’attendait à voir
Les arbres s’enflammer du sommet à la base.
J’étais couché sur l’herbe auprès du vieux bateau
Où des femmes lavaient leur linge. Des eaux grasses,
Des bulles de savon qui se crevaient bientôt
S’en allaient au courant, laissant de longues traces.
Et je m’assoupissais lorsque je vis venir,
Sous la grande lumière et la chaleur torride,
Une fille marchant d’un pas ferme et rapide,
Avec ses bras levés en l’air, pour maintenir
Un fort paquet de linge au-dessus de sa tête.
La hanche large avec la taille mince, faite
Ainsi qu’une Vénus de marbre, elle avançait
Très droite, et sur ses reins, un peu, se balançait.
Je la suivis, prenant l’étroite passerelle
Jusqu’au seuil du lavoir, où j’entrai derrière elle.
Elle choisit sa place, et dans un baquet d’eau,
D’un geste souple et fort abattit son fardeau.
Elle avait tout au plus la toilette permise ;
Elle lavait son linge ; et chaque mouvement
Des bras et de la hanche accusait nettement,
Sous le jupon collant et la mince chemise,
Les rondeurs de la croupe et les rondeurs des seins.
Elle travaillait dur ; puis, quand elle était lasse,
Elle élevait les bras, et, superbe de grâce,
Tendait son corps flexible en renversant ses reins.
Mais le puissant soleil faisait craquer les planches ;
Le bateau s’entr’ouvrait comme pour respirer.
Les femmes haletaient ; on voyait sous leurs manches
La moiteur de leurs bras par place transpirer
Une rougeur montait à sa gorge sanguine.
Elle fixa sur moi son regard effronté,
Dégrafa sa chemise, et sa ronde poitrine
Surgit, double et luisante, en pleine liberté,
Écartée aux sommets et d’une ampleur solide.
Elle battait alors son linge, et chaque coup
Agitait par moment d’un soubresaut rapide
Les roses fleurs de chair qui se dressent au bout.
Un air chaud me frappait, comme un souffle de forge,
A chacun des soupirs qui soulevaient sa gorge.
Les coups de son battoir me tombaient sur le coeur !
Elle me regardait d’un air un peu moqueur ;
J’approchai, l’oeil tendu sur sa poitrine humide
De gouttes d’eau, si blanche et tentante au baiser.
Elle eut pitié de moi, me voyant très timide,
M’aborda la première et se mit à causer.
Comme des sons perdus m’arrivaient ses paroles.
Je ne l’entendais pas, tant je la regardais.
Par sa robe entr’ouverte, au loin, je me perdais,
Devinant les dessous et brûlé d’ardeurs folles ;
Puis, comme elle partait, elle me dit tout bas
De me trouver le soir au bout de la prairie.
Tout ce qui m’emplissait s’éloigna sur ses pas ;
Mon passé disparut ainsi qu’une eau tarie :
Pourtant j’étais joyeux, car en moi j’entendais
Les ivresses chanter avec leur voix sonore.
Vers le ciel obscurci toujours je regardais,
Et la nuit qui tombait me semblait une aurore !
II
Elle était la première au lieu du rendez-vous.
J’accourus auprès d’elle et me mis à genoux,
Et promenant mes mains tout autour de sa taille
Je l’attirais. Mais elle, aussitôt, se leva
Et par les prés baignés de lune se sauva.
Enfin je l’atteignis, car dans une broussaille
Qu’elle ne voyait point son pied fut arrêté.
Alors, fermant mes bras sur sa hanche arrondie,
Auprès d’un arbre, au bord de l’eau, je l’emportai.
Elle, que j’avais vue impudique et hardie,
Était pâle et troublée et pleurait lentement,
Tandis que je sentais comme un enivrement
De force qui montait de sa faiblesse émue.
Quel est donc et d’où vient ce ferment qui remue
Les entrailles de l’homme à l’heure de l’amour ?
La lune illuminait les champs comme en plein jour.
Grouillant dans les roseaux, la bruyante peuplade
Des grenouilles faisaient un grand charivari ;
Une caille très loin jetait son double cri,
Et, comme préludant à quelque sérénade,
Des oiseaux réveillés commençaient leurs chansons.
Le vent me paraissait chargé d’amours lointaines,
Alourdi de baisers, plein des chaudes haleines
Que l’on entend venir avec de longs frissons,
Et qui passent roulant des ardeurs d’incendies.
Un rut puissant tombait des brises attiédies.
Et je pensai : « Combien, sous le ciel infini,
Par cette douce nuit d’été, combien nous sommes
Qu’une angoisse soulève et que l’instinct unit
Parmi les animaux comme parmi les hommes. »
Et moi j’aurais voulu, seul, être tous ceux-là !
Je pris et je baisai ses doigts ; elle trembla.
Ses mains fraîches sentaient une odeur de lavande
Et de thym, dont son linge était tout embaumé.
Sous ma bouche ses seins avaient un goût d’amande
Comme un laurier sauvage ou le lait parfumé
Qu’on boit dans la montagne aux mamelles des chèvres.
Elle se débattait ; mais je trouvai ses lèvres :
Ce fut un baiser long comme une éternité
Qui tendit nos deux corps dans l’immobilité.
Elle se renversa, râlant sous ma caresse ;
Sa poitrine oppressée et dure de tendresse,
Haletait fortement avec de longs sanglots ;
Sa joue était brûlante et ses yeux demi-clos,
Et nos bouches, nos sens, nos soupirs se mêlèrent.
Puis, dans la nuit tranquille où la campagne dort,
Un cri d’amour monta, si terrible et si fort
Que des oiseaux dans l’ombre effarés s’envolèrent.
Les grenouilles, la caille, et les bruits et les voix
Se turent ; un silence énorme emplit l’espace.
Soudain, jetant aux vents sa lugubre menace,
Très loin derrière nous un chien hurla trois fois.
Mais quand le jour parut, comme elle était restée,
Elle s’enfuit. J’errai dans les champs au hasard.
La senteur de sa peau me hantait ; son regard
M’attachait comme une ancre au fond du coeur jetée.
Ainsi que deux forçats rivés aux mêmes fers,
Un lien nous tenait, l’affinité des chairs.
III
Pendant cinq mois entiers, chaque soir, sur la rive,
Plein d’un emportement qui jamais ne faiblit,
J’ai caressé sur l’herbe ainsi que dans un lit
Cette fille superbe, ignorante et lascive.
Et le matin, mordus encor du souvenir,
Quoique tout alanguis des baisers de la veille,
Dès l’heure où, dans la plaine, un chant d’oiseau s’éveille,
Nous trouvions que la nuit tardait bien à venir.
Quelquefois, oubliant que le jour dût éclore,
Nous nous laissions surprendre embrassés, par l’aurore.
Vite, nous revenions le long des clairs chemins,
Mes deux yeux dans ses yeux, ses deux mains dans mes mains.
Je voyais s’allumer des lueurs dans les haies,
Des troncs d’arbre soudain rougir comme des plaies,
Sans songer qu’un soleil se levait quelque part,
Et je croyais, sentant mon front baigné de flammes,
Que toutes ces clartés tombaient de son regard.
Elle allait au lavoir avec les autres femmes ;
Je la suivais, rempli d’attente et de désir.
La regarder sans fin était mon seul plaisir,
Et je restais debout dans la même posture,
Muré dans mon amour comme en une prison.
Les lignes de son corps fermaient mon horizon ;
Mon espoir se bornait aux noeuds de sa ceinture.
Je demeurais près d’elle, épiant le moment
Où quelque autre attirait la gaieté toujours prête ;
Je me penchais bien vite, elle tournait la tête,
Nos bouches se touchaient, puis fuyaient brusquement.
Parfois elle sortait en m’appelant d’un signe ;
J’allais la retrouver dans quelque champ de vigne
Ou sous quelque buisson qui nous cachait aux yeux.
Nous regardions s’aimer les bêtes accouplées,
Quatre ailes qui portaient deux papillons joyeux,
Un double insecte noir qui passait les allées.
Grave, elle ramassait ces petits amoureux
Et les baisait. Souvent des oiseaux sur nos têtes
Se becquetaient sans peur, et les couples des bêtes
Ne nous redoutaient point, car nous faisions comme eux.
Puis le coeur tout plein d’elle, à cette heure tardive
Où j’attendais, guettant les détours de la rive,
Quand elle apparaissait sous les hauts peupliers,
Le désir allumé dans sa prunelle brune,
Sa jupe balayant tous les rayons de Lune
Couchés entre chaque arbre au travers des sentiers,
Je songeais à l’amour de ces filles bibliques,
Si belles qu’en ces temps lointains on a pu voir,
Éperdus et suivant leurs formes impudiques,
Des anges qui passaient dans les ombres du soir.
IV
Un jour que le patron dormait devant la porte,
Vers midi, le lavoir se trouva dépeuplé.
Le sol brûlant fumait comme un boeuf essoufflé
Qui peine en plein soleil ; mais je trouvais moins forte
Cette chaleur du ciel que celle de mes sens.
Aucun bruit ne venait que des lambeaux de chants
Et des rires d’ivrogne, au loin, sortant des bouges,
Puis la chute parfois de quelque goutte d’eau
Tombant on ne sait d’où, sueur du vieux bateau.
Or ses lèvres brillaient comme des charbons rouges
D’où jaillirent soudain des crises de baisers,
Ainsi que d’un brasier partent des étincelles,
Jusqu’à l’affaissement de nos deux corps brisés.
On n’entendait plus rien hormis les sauterelles,
Ce peuple du soleil aux éternels cris-cris
Crépitant comme un feu parmi les prés flétris.
Et nous nous regardions, étonnés, immobiles,
Si pâles tous les deux que nous nous faisions peur ;
Lisant aux traits creusés, noirs, sous nos yeux fébriles,
Que nous étions frappés de l’amour dont on meurt,
Et que par tous nos sens s’écoulait notre vie.
Nous nous sommes quittés en nous disant tout bas
Qu’au bord de l’eau, le soir, nous ne viendrions pas.
Mais, à l’heure ordinaire, une invincible envie
Me prit d’aller tout seul à l’arbre accoutumé
Rêver aux voluptés de ce corps tant aimé,
Promener mon esprit par toutes nos caresses,
Me coucher sur cette herbe et sur son souvenir.
Quand j’approchai, grisé des anciennes ivresses,
Elle était là, debout, me regardant venir.
Depuis lors, envahis par une fièvre étrange,
Nous hâtons sans répit cet amour qui nous mange
Bien que la mort nous gagne, un besoin plus puissant
Nous travaille et nous force à mêler notre sang.
Nos ardeurs ne sont point prudentes ni peureuses ;
L’effroi ne trouble pas nos regards embrasés ;
Nous mourons l’un par l’autre, et nos poitrines creuses
Changent nos jours futurs comme autant de baisers.
Nous ne parlons jamais. Auprès de cette femme
Il n’est qu’un cri d’amour, celui du cerf qui brame.
Ma peau garde sans fin le frisson de sa peau
Qui m’emplit d’un désir toujours âpre et nouveau,
Et si ma bouche a soif, ce n’est que de sa bouche !
Mon ardeur s’exaspère et ma force s’abat
Dans cet accouplement mortel comme un combat.
Le gazon est brûlé qui nous servait de couche,
Et désignant l’endroit du retour continu,
La marque de nos corps est entrée au sol nu.
Quelque matin, sous l’arbre où nous nous rencontrâmes,
On nous ramassera tous deux au bord de l’eau.
Nous serons rapportés au fond d’un lourd bateau,
Nous embrassant encore aux secousses des rames.
Puis, on nous jettera dans quelque trou caché,
Comme on fait aux gens morts en état de péché.
Mais alors, s’il est vrai que les ombres reviennent,
Nous reviendrons, le soir, sous les hauts peupliers,
Et les gens du pays, qui longtemps se souviennent,
En nous voyant passer, l’un à l’autre liés,
Diront, en se signant, et l’esprit en prière :
« Voilà le mort d’amour avec sa lavandière. »
Guy de Maupassant, Des vers
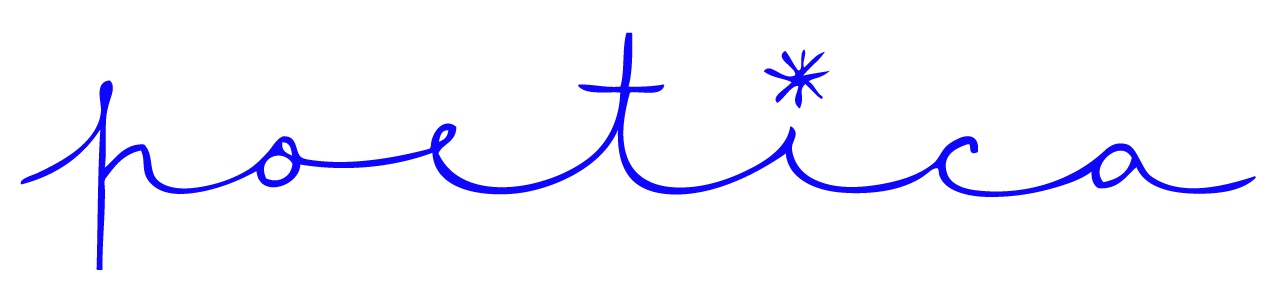

Belle accroche pour un devoir de géographie sur l’eau
Van Gucht nous dit que c’est un viol. La demoiselle se débat un peu c’est vrai, mais pour mieux se laisser prendre. C’est un jeu d’amour. Y voir un viol est une aberration. Par contre ce qui ressort au-delà de la sensualité c’est une lourdeur, une angoisse, voire une certaine horreur. D’ailleurs cela fini mal. Ce n’est pas « joli », c’est plutôt proche du sordide, mais à peine, sans y insister. C’est toute l’ambigüité de l’amour charnel, entre dégoût et félicité. Maupassant aimait-il vraiment les femmes ?
Magnifique !
C’est quand même un viol !
Trop magnifique ! Je l’ai appris par cœur pour le réciter devant la classe et la prof en a pleuré !… bravo Maupassant !
Magnifique !
C’est bien beau.
Une fatalité sensuelle et tragique… Impressionnant…
Ce poème dégage un vécu qui ne saurait s’exprimer sous un format court. Extrêmement émouvant et digne d’une tragédie antique.
Le vent, les parfums, la nature autour , l’amour partout sous la peau, sur les lèvres, sous les aisselles, sur l’auréole bleutée, dans les herbes, dans chaque goutte d’eau qui ruisselle sous le soleil de l’étreinte… et ce chant d’amour qui éclate comme le bouquet d’un arc en ciel d’artifice, point d’orgue d’une mélodie d’amour entonnée chaque jour par la terre tout entière… et tout ca au bord d’un lavoir… L’avoir? ou simplement la voir?
C BO
Super long, mais magnifique.
Mourir d’amour? soit !! mais comme Brassens dans « mourir pour des idées », de mort lente
C’est un très beau poème, très long…
Pour répondre à la question et d’après la chronologie de l’éditeur trouvé dans les nouvelles « Le Rosier de Mme Husson »:
– 1ère date de publication: 20 mars 1876 sous le titre « Au bord de l’eau » et sous la signature de Guy de Valmont, dans « La république des lettres » de Catulle Mendès.
– 2ème publication en décembre 1879, dans « La revue moderne et naturaliste », sous le titre d' »Une fille ». Le parquet d’Etampes l’invite à comparaitre. Flaubert, qui n’a pas oublié le procès de 3madame Bovary », intervient et le conseille. Il est convoqué par le juge d’instruction le 14 février 1880, puis une ordonnance de non-lieu sera prononcée.
Voilà pour l’Histoire. Magnifique poème érotique et naturaliste en tous les cas!
Meilleur conteur que poète, il le démontrera par la suite. Tout cela s’apparente plutôt à la nouvelle, la poésie, pour moi, ne devrait pas respecter ce genre de schéma ou bien elle est vile et primaire. Beaucoup de lourdeur ici, ce n’est pas le Maupassant que j’aime ..
en tt cas je comprend les personnes qui disent que ce poème est génial car le poète a beaucoup d’imagination pour faire un poème aussi long que ça!!!!
Quelle est la date de publication svp ? 😀
Beau….
Le plus beau des chants d’amour !
ouais, bah, il est long mais bien
jolie