Elle est retrouvée.
Quoi ? – L’Eternité.
C’est la mer allée
Avec le soleil.
Ame sentinelle,
Murmurons l’aveu
De la nuit si nulle
Et du jour en feu.
Des humains suffrages,
Des communs élans
Là tu te dégages
Et voles selon.
Puisque de vous seules,
Braises de satin,
Le Devoir s’exhale
Sans qu’on dise : enfin.
Là pas d’espérance,
Nul orietur.
Science avec patience,
Le supplice est sûr.
Elle est retrouvée.
Quoi ? – L’Eternité.
C’est la mer allée
Avec le soleil.
Arthur Rimbaud, Derniers vers
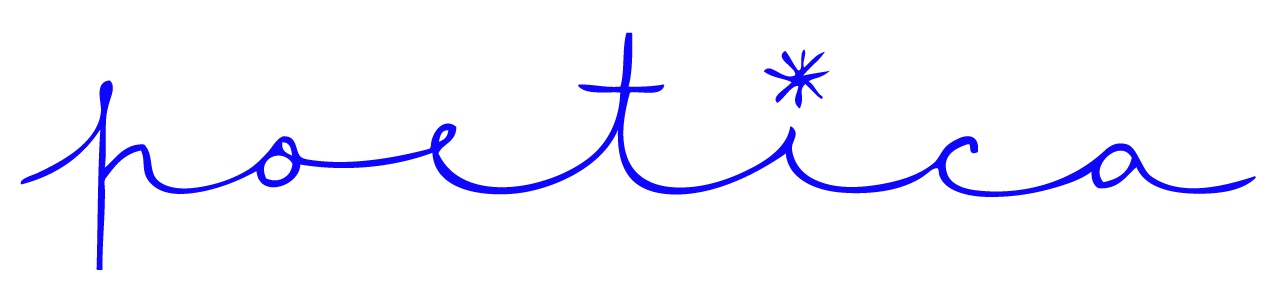

Une erreur de positionnement à corriger et une remarque d’importance à faire, qui vient de m’apparaître avec force :
– J’ai écrit précédemment : « A noter que la tonalité plus sombre de « Une Saison en enfer », le désespoir profond qui marque cette œuvre, a repoussé dans « Alchimie du verbe » la 3ème strophe sur « les braises de satin » à la 5ème place, les rattachant désormais non plus à l’envol de « l’âme sentinelle » mais à « l’absence d’espérance » et au « supplice sûr » etc. ».
Or les « braises de satin » de « L’Eternité », version « Derniers vers », sont dans la 4ème strophe, et non la 3ème.
– En fait la version de « L’Eternité » donnée dans « Alchimie du verbe » (in « Une Saison en enfer ») inverse tout simplement l’ordre des 4ème et 5ème strophe de la version des « Derniers vers » proposée par le site et étudiée ici.
J’en rappelle la forme modifiée dans la « Saison » :
« – Jamais d’espérance
Pas d’orietur.
Science et patience,
Le supplice est sûr.
Plus de lendemain,
Braises de satin,
Votre ardeur
Est le devoir. »
– Le travail de « dynamitage » effectué est donc plus systématique que ce que j’ai cru de prime abord et il ne s’agit pas d’un « mélange arbitraire des vers ».
– Je pense qu’il faut voir dans cette « inversion », non pas un renversement positif comme pour la mer « (en) allée avec le soleil » qui voudrait exprimer l’éternité par l’inversion du temps et la victoire finale de la lumière sur la nuit, mais bien une inversion de type satanique, une « subversion » au sens premier, tout à fait dans l’esprit du recueil : par l’interversion des strophes Rimbaud retourne les signes et plonge dans l’enfer du « devoir » et du « No future » le vol solaire des « Derniers vers »…
Il y a peut-être une autre interprétation possible de la 5ème strophe (« Là pas d’espérance, /Nul orietur, /Science avec patience, /Le supplice est sûr »), la plus difficile à comprendre et à relier au sens général du poème, et sur laquelle mon interprétation peut être discutée, et est sans doute discutable (je m’attendais d’ailleurs à des réactions…) : je vais détailler in fine cette nouvelle possible « exégèse »…
– Je maintiens que l’image du lever de soleil ne renvoie à nul spectacle réel (sinon Rimbaud aurait décrit un lever de soleil sur les arbres du lycée Saint-Louis ou sur les toits de zinc du quartier latin), mais n’est qu’invention poétique, « figure de style » à prendre au sens propre, consécutive à l’Illumination première, illumination qui est soudaine compréhension de l’être, que cette compréhension relève de la science (Descartes), de la foi (Pascal) ou de l’Amour universel (Rimbaud).
– Quand j’ai écrit ailleurs (pour le « steamer » de « Brise marine ») que la parole poétique n’était « jamais référentielle », je dois préciser : à un niveau premier, mais la métaphore renvoie à une référence plus essentielle et profonde à un niveau second qui est de fait premier dans l’ordre de l’être (lire sur ce point les développements décisifs de Paul Ricoeur sur le sens de la métaphore, avec ses deux degrés, et de la « mimesis » poétique qui n’est pas imitation mais réinvention, comme l’entendait Aristote).
– Je maintiens que le « Devoir » de la 4ème strophe est celui de témoigner des « braises de satin » qui ont « brûlé » au petit matin le cœur du Poète (expression oxymorique qui rappelle le « supplice » amoureux à la fois cruel et doux au cœur des amants : la fameuse « passion ») et lui ont permis de prendre son envol : « témoigner » veut dire ici « avouer cet Amour» dans et par le poème, comme seul le martyr sait témoigner de la vérité qu’il porte en lui jusqu’au témoignage suprême de la mort (« Il n’y a pas de plus grand amour… »). Il y a un lien de conséquence à cause (« puisque ») entre la 3ème strophe qui parle de « l’envol » et la 4ème qui évoque le « Devoir exhalé des braises de satin » : l’âme sentinelle est libre et peut s’envoler « puisque » le Devoir auquel elle aspire et après l’accomplissement duquel elle court s’exhale « enfin » des « braises de satin » et n’est plus à chercher …
– A noter que la tonalité plus sombre de « Une Saison en enfer », le désespoir profond qui marque cette œuvre, a repoussé dans « Alchimie du verbe » la 3ème strophe sur « les braises de satin » à la 5ème place, les rattachant désormais non plus à l’envol de « l’âme sentinelle » mais à « l’absence d’espérance » et au « supplice sûr », ôtant au passage au « devoir » sa majuscule initiale, avec un « plus de lendemain » en tête de strophe qui n’est pas dans la première version, entraînant de facto une modification de la tonalité du poème et de l’interprétation que l’on peut en faire comme j’y reviendrai en fin de commentaire. « Alchimie du verbe » coupe d’ailleurs le poème en deux parties égales, comme deux versants d’une montagne (l’adret ensoleillé et l’ubac ombragé), parties séparées par un tiret, une sorte de ligne de crête au début de la 3ème strophe.
– Pour revenir à la version des « Derniers vers », il y a un autre poème de Rimbaud qui va dans le sens de ce puissant Amour porté à l’humanité ressenti au petit matin, c’est « Bonne pensée du matin » qui précède les « Fêtes de la patience » et qui remonte lui aussi à mai 1872 : là aussi il est question d’amour matutinal (« A quatre heures du matin, l’été, /Le sommeil d’amour dure encore » et plus loin il est fait allusion à un « soleil des Hespérides », c’est-à-dire là aussi à une « aurore du soir », les Hespérides étant les filles d’Hespéris, l’Occident, le couchant personnifié : « Là-bas, dans l’immense chantier, /Vers le soleil des Hespérides »), d’un amour qui s’épanche sur les « ouvriers charmants,/ Sujets d’un roi de Babylone » : « Vénus ! […] Porte aux travailleurs l’eau de vie » etc.
– Amour d’un amour qui emplit l’âme du poète à la pointe du jour et cherche à se fixer sur un objet : « Nondum amabam et amare amabam [..] quaerebans quid amarem, amans amare » écrit Saint Augustin (« Je n’aimais pas encore, et j’aimais à aimer (…). Je cherchais un objet à mon amour, aimant à aimer »). On peut penser effectivement que les « ouvriers » sont des « ouvriers » idéalisés, rêvés, qu’il ne voyait pas au moment d’écrire en tout cas, symboles d’une humanité en marche dans et par le travail libérateur (on est au début de l’industrialisation en France) et sur lesquels va se fixer l’amour du poète…
N’écrit-il pas dans « L’Eclair », poème de la « Saison » : « Le travail humain ! c’est l’explosion qui éclaire mon abîme de temps en temps. » ?
– Et ailleurs, dans la belle lettre déjà citée de juin 1872 à son ami d’enfance Ernest Delahaye, Rimbaud parle de manière amoureuse de « cette heure indicible, première du matin »…
– Je maintiens cependant que dans le poème ce n’est pas le Poète qui parle mais que « ça parle en lui » (comme il est analysé dans les « Lettres du voyant »), que le murmure poétique s’exhale de nulle part, à partir d’aucune sub-stance limitée et limitative (d’aucune « sub-jectité »), d’où l’impression d’extrême liberté (« Liberté » aurait d’ailleurs pu être l’autre titre du poème) de cette parole immatérielle : portée par la musicalité du vers pentasyllabique elle peut alors accompagner le mouvement de l’âme sentinelle, épouser son envol vers ses noces de feu, être ce vol-même dans un verbe performatif qui est le propre de la grande poésie !
– « Infinité, Liberté et Eternité » forment, je crois, le triptyque de ce poème à la fois aérien et incandescent, mais l’Eternité est la plus forte (comme la Charité par rapport aux trois vertus théologales, selon Saint Paul) et les englobe toutes trois (d’où le titre) puisque le temps est l’essence de l’être, ce que Rimbaud, comme Kant avant lui et Bergson ou Heidegger après, a parfaitement compris par sa seule intuition poétique !
– J’en arrive à cette 5ème strophe de la version des « Derniers vers » (« Là pas d’espérance, / Nul orietur etc. », la 4ème d’« Alchimie du verbe » légèrement modifiée) pour indiquer une autre interprétation que l’on pourrait en faire, notamment concernant l’« absence d’espérance » et le « supplice ».
– J’avais précédemment interprété le « Là » comme le « là de l’ouverture de l’être », le déictique indiquant l’entrée « hic et nunc » de l’âme sentinelle dans sa propre éclaircie, au terme de son envol.
– Je maintiens que l’âme rentre dans l’éclaircie, c’est tout le sens du poème, mais peut-être convient-il de ne plus interpréter le « là » comme le « là de l’être », mais plutôt comme celui tout à l’inverse de « l’ici-bas » ! « Là, tu te dégages », voudrait alors dire : « de là, des humains suffrages, des communs élans, tu te dégages » et « Là, pas d’espérance » devient de manière encore plus décisive : « ici-bas, pas d’espérance », ce qui change évidemment du tout au tout le sens de la strophe, de la « science », de la « patience » et surtout de ce « supplice » plus aisément saisissable alors.
– Du coup, le « devoir » d’« Alchimie du verbe » n’a plus du tout le même sens que le « Devoir » des « Derniers vers », et devient un « devoir » au sens « corvée » du terme, puisque le voilà rattaché au « supplice » et à l’ « absence d’espérance »… et l’on voit le mot déchu perdre sa majuscule, comme un roi renversé perd sa couronne.
– On a l’impression dans la version de la « Saison » que le poète a voulu de rage « casser le jouet » en faisant perdre au poème initial sa dimension spirituelle et amoureuse au sens fort et universel, toute sa belle liberté, sa logique poétique, pour le faire sombrer dans une sorte d’automatisme de l’expression en mélangeant arbitrairement les vers : les « braises de satin » sont devenues des « braises de Satan » et l’on se retrouve vraiment en enfer ! Car pour le Rimbaud de 1873 le projet initial de 1872 n’avait plus aucun sens et il le tourne en dérision (on sait que le ricanement était l’un de ses principaux défauts s’accroissant avec l’âge jusqu’à étouffer la voix du poète) : « De joie je prenais une expression bouffonne et égarée au possible : », avant de réécrire le poème en le dynamitant…
– C’est pour avoir voulu à tout prix sauvegarder une unité de sens entre les deux versions, en faire une lecture synchronique et rattacher le « Devoir » au « supplice » conformément à la version de la « Saison », que j’ai voulu voir dans le « supplice » de la version des « Derniers vers », le supplice d’amour, et dans la « science » la « gaie science » (même si la « gaie science » reste présente dans le poème, mais pas là où le mot de « science » apparait), or rien n’est moins « sûr », c’est le cas de le dire… Il faut garder, je le pense désormais, une lecture diachronique des deux versions et ne pas « forcer le sens ».
– L’édition de Louis Forestier chez Gallimard, folio classique, 1999, préfacée par René Char en 1965, va dans ce sens et je vous en livre la très brève et percutante note de commentaire : « La certitude que l’Eternité s’enferme dans l’instant d’une vision, l’aube, fournit à Rimbaud une solution et lui permet de se dégager (voir variante du même texte contenu dans « Une Saison en enfer » : « Alchimie du verbe ») d’un quotidien que nulle promesse d’espérance n’illumine. »
– Je vous laisse juges… et si vous souhaitez en débattre…
Reprenons les conclusions auxquelles nous sommes parvenus précédemment pour les clarifier et ouvrir de nouvelles perspectives tellement la richesse du poème est inépuisable.
Le poème traite de « L’Eternité », c’est-à-dire d’un temps arrêté… ou qui ne s’arrête jamais (la parole ne pouvant échapper au temps, l’antithèse est l’un des outils rhétoriques à notre disposition pour exprimer l’inexprimable : le « hors-du-temps », le « au-delà du temps »).
Le poète, qui est un artiste et travaille sur la matière des mots, suggère l’éternité au moyen de la transcription dans l’espace -transcription élaborée par son imagination (faculté de créer des images) créatrice- de ce qui est sans doute une expérience métaphysique et donc ontologiquement inscrite dans le temps : celle d’une illumination où « l’âme sentinelle » (qui est « l’autre » de Rimbaud) décorporée s’enflamme au feu de la Charité dans un ultime « supplice » sacrificiel.
Car cette âme dans sa migration soudaine et illuminative a acquis la « science » de la « patience » (« science » [rime] avec « patience »), c’est-à-dire la Sagesse, ou encore l’Amour qui est com-préhension et acceptation de mourir à son individualité pour renaître libre et donc éternelle : la liberté libre est bien dans l’acceptation du « Devoir » de s’accorder avec la Nature, de se soumettre à son Feu régénérateur primordial (« les braises de satin »).
Il faut refuser toute lecture du poème comme expression d’une quelconque sensualité épidermique (comme dans « Sensation », par exemple) qui s’éveillerait au soleil couchant (ou levant), car alors l’évocation du « Devoir » (avec majuscule dans l’autographe), du « pas d’espérance », de la « science » et, last but not least, du « supplice » serait proprement incompréhensible !
C’est à un tout autre niveau de l’expérience de l’être que se situe le poème.
Dans un premier temps cette vision semble être celle d’un « coucher de soleil » figé dans l’instant éternisé de l’intuition (perception immédiate d’une vérité sans l’aide du raisonnement). Cette fixité comme expression de l’éternité siérait bien au Baudelaire platonicien héritier pour une part du Parnasse et de son culte d’une Beauté idéalisée hors du temps, cultivée pour elle-même et restée immobile dans le ciel des Idées (« Je hais le mouvement qui déplace les lignes », dit la Beauté), elle ne sied pas au Rimbaud héraclitéen, poète de la dynamique des départs définitifs dans « l’affection et le bruit neufs », promoteur d’une poétique mouvante, en avant d’une action non plus sœur mais fille du rêve…
Nous avons vu que ce coucher de soleil était en fait un coucher inversé, une « aurore du soir », davantage qu’un « crépuscule du matin », sans lire dans cette formulation antinomique un quelconque « oxymore » qui voudrait harmoniser deux termes opposés en gommant la force de l’opposition dans une sorte de sfumato exotique très baudelairien, mais plutôt une « antithèse » qui maintient la tension de l’opposition des pôles et donne à la formule toute sa force a-normale et révolutionnaire…
Oui, il faut voir dans cette inversion de la norme cosmique et la victoire définitive de la lumière sur la nuit (car il n’est pas équivalent de dire : « la mer va avec le soleil », ce qui n’arrive jamais, et : « le soleil va avec la mer », ce qui n’arrive qu’au crépuscule, mais alors le soleil n’est pas victorieux à la fin) l’abolition du temps qui s’exprime dans et par le temps renversé : ici « le soleil [ne] s’est [pas] noyé dans son sang qui se fige» (pour reprendre Baudelaire), mais c’est la mer qui s’évapore dans le soleil, qui est enlevée par, élevée jusqu’au soleil, et seules restent in fine le « jour en feu » et « les braises de satin » dans lesquelles « l’âme sentinelle » du Poète va se consumer à l’aurore d’une « nuit si nulle » de mai 1872, à Paris, pour atteindre à l’éternité…
On pense à Pascal et à la « nuit de feu » du Mémorial en 1654, mais aussi à Descartes et au songe qui, 35 ans plus tôt, une nuit de 1619, dans un éclair, illumina le cerveau du jeune homme, le remplit d’enthousiasme et lui apporta la révélation d’une « science admirable » (voir l’intéressant article de Pierre Thévenaz sur les « Deux nuits de novembre – La « nuit de Descartes » et la « nuit de Pascal »- 1943 ») : c’est le même feu, n’en doutons pas, qui brûle ici Rimbaud, celui de l’Amour et de la Science, de la Science d’Amour, le « Gay Saber » ou la « Gaie Science » des troubadours, si l’Amour dans sa vérité se caractérise avant tout par la com-préhension de l’être : voir le poème précédent des « Fêtes de la patience », qui est une « chanson médiévale» digne du « Canzoniere », « La Chanson de la plus haute tour » : « Ah ! que le temps vienne où les cœurs s’éprennent !»…
Alors ? Peut-on lire « L’Eternité » comme « la nuit mystique » de Rimbaud, d’un mysticisme païen attaché au culte du feu des Anciens (rappelons-nous : « J’ai de mes ancêtres gaulois l’œil bleu blanc etc.» et plus loin : «[…] boire des liqueurs fortes comme du métal bouillant,- comme faisaient ces chers ancêtres autour des feux ? »), d’un feu néanmoins tout intérieur ici (à moins que « les liqueurs fortes » n’y soient pas totalement étrangères, l’histoire ne le dit pas) qui se projette à travers la parole poétique murmurée vers un spectacle grandiose et réinventé de la Nature ?
En 1873, dans le prologue de la « Saison en enfer », Rimbaud donne peut-être une indication allant dans le sens de cette lecture « charitable » du poème : « Or tout dernièrement, m’étant trouvé sur le point de faire le dernier couac ! j’ai songé à rechercher la clé du festin ancien, où je reprendrais peut-être appétit. La charité est cette clef. – Cette inspiration prouve que j’ai rêvé ! » : la « charité » comme « clé du festin ancien » : celui de mai 1872 ? Aveu décisif, avant le reniement tout aussitôt…
Décidément le Rimbaud désabusé de la « Saison » d’avril 1873 n’est plus le Rimbaud visionnaire de « L’Eternité » de mai 1872 (le plus grand peut-être), qui n’est plus le Rimbaud sensuel de « Sensation » de mars 1870…
Comme l’enfant après l’aube, le poète continuera quelque temps encore, jusqu’en 1875, de courir derrière une illusoire éternité littéraire (peut-on le nier avec les manuscrits des « Illuminations », feuillets épars transmis à des connaissances et amis ?), et il la trouvera finalement malgré lui au terme d’une course africaine brisée et alors qu’il aura cessé d’y penser depuis longtemps, grâce à ses poèmes, ses merveilleux poèmes -dont «L’Eternité » est l’un des plus beaux joyaux, au côté de « Aube » ou de « Génie »-, des « rinçures » selon ses propres termes qui l’attendaient à son retour, très efficacement mis en valeur par le fidèle et Pauvre Lelian, entre autres, malgré les violentes ruptures, et ne cessent depuis et pour l’éternité de marquer d’une trainée d’or dans le firmament des poètes les traces aimantées de ce passant considérable …
Continuons notre méditation sur cette « Eternité » au risque de tourner en rond, voire de nous contredire sur certains points, ce qui est le propre de toute recherche vivante (et merci à « Poetica » de nous permettre cette recherche). Souhaitons néanmoins que ce cercle soit hélicoïdal et non clos et vicieux, et qu’il nous permette d’avancer et de nous enfoncer en profondeur dans la vérité de l’œuvre.
Nous l’avons vu, le poème est vision d’éternité car il est expérience intérieure d’éternité, bien au-delà de tout spectacle cosmique particulier, de tout « coucher de soleil » dont aurait été témoin le poète : « la mer allée avec le soleil » n’est pas à l’origine du poème, mais c’est le poème qui suscite la vision, la (re)crée, comme Dieu créa la mer, la terre et les « luminaires » à l’ouverture de la Genèse : « Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour », première strophe.
Dans et par le poème, le poète rentre dans l’éclaircie de l’être (le « là-de-l’être», déictique qui revient deux fois dans le poème), seule vraie lumière éternelle, et dépasse les limites étroites de son « je » personnel. La « mer » et le « soleil » sont d’ailleurs évoqués hors de tout point de vue interne particulier : « L’éternité ? C’est la mer allée avec le soleil » : qui parle ici ? La Parole. Puis la Parole s’adresse à « l’âme sentinelle » dans un deuxième temps, ou deuxième strophe, pour l’inviter par le « murmure » partagé à « annuler la nuit », sa nuit, et avouer le « jour en feu »…
« Il y eut un soir, il y eut un matin qui n’eut plus de fin »…
Comme la chouette de Minerve dans le soir, l’âme s’envole alors sur l’aile de la Parole « murmurée », loin de la nuit des « humains suffrages et des communs élans », se brûle au « feu du jour » et disparaît ; aucun « je » ici : seul apparait le « nous » de « l’aveu murmuré » en commun, puis le « tu » adressé à cette même âme par la Parole et que le pur regard poétique voit s’envoler au soleil, et enfin l’impersonnalité d’un « on » qui se perd dans les « braises de satin » en accomplissant son « devoir [d’être] », âme déjà dépersonnalisée : l’âme doit répondre à cet appel d’être comme à son destin le plus essentiel…
Cette « science patiente » au-delà de toute science humaine (par définition impatiente de connaître un étant particulier) est la science de l’Etre, le Savoir suprême : plus de « enfin » impatient, plus « d’espérance » qui est une attente dans le temps, plus « d’orietur » qui est « (re)naissance » quotidienne…
Mais cet envol se fait au prix du « supplice sûr», inévitable et nécessaire (destinal), de l’âme individuelle, au prix du sacrifice de la « subjectité » détruite, annihilée, pour déboucher, enfin « dégagée », dans l’ouvert de l’étant…
Il y a d’ailleurs dans le poème, si l’on y regarde bien, une inversion apocalyptique (c’est-à-dire révélatrice) de la temporalité « normale », ce en quoi le poème ne peut être la description d’un « coucher », ni même d’un « lever de soleil » réels : dans l’ordre cosmique des choses, vécu du moins phénoménologiquement (c’est-à-dire d’un point de vue humain), c’est « le soleil qui va avec la mer », « s’immerge » au crépuscule ou « émerge » à l’aube : la mer (ou la terre, le sol) est l’élément fixe, le référentiel dans notre perception du mouvement des planètes.
Or ici, étrangement, c’est « la mer qui va avec le soleil » et semble attirée à lui dans une sorte de crépuscule inversé : un « crépuscule du matin », un crépuscule oriental en quelque sorte, car seul au crépuscule le soleil rejoint la mer, mais seul à l’aurore le soleil est victorieux sur la mer… Ici le soleil et la mer se « mêlent » bien (selon le terme employé dans la « Saison »), mais l’on croit voir la mer s’élever vers le soleil pour s’y évaporer, et le soleil obtient seul la victoire finale : plus aucune trace d’élément liquide dans la suite du poème, tout n’y est plus que « feu », « braises seules» … on est loin d’un soleil vaincu et humilié, assassiné, qui se serait « noyé dans son sang qui se fige ».
Nous sommes bien à l’aube d’un nouveau monde, nous assistons à la naissance d’un nouvel ordre grâce au « murmure » matutinal de la Parole poétique initiale qui a su emporter avec elle « l’âme sentinelle »…
Prenons au pied de la lettre ce beau symbole cosmique inversé, et voyons-y l’image même en abyme de l’Eternité : l’abolition de tout crépuscule -et donc la négation de la nuit, de la mort, du temps-, la révélation d’un soleil qui est devenu le nouveau « sol » de notre monde, sa base renversée, sa référence, sa seule vérité spirituelle, et qui engloutit la mer dans une aurore éternelle…
La « Mer », vous l’aurez compris, c’est la mort, « la nuit si nulle » de l’âme individuelle, l’âme isolée, en exil et vouée à la mort ; le « Soleil » c’est la clarté de l’Etre, son « là » vers lequel « l’âme sentinelle », l’âme éveillée, migre à l’approche de l’hiver terrestre des « humains suffrages » pour y demeurer en vie éternellement ; «le Supplice », c’est la migration de « l’âme sentinelle », l’œuvre au noir qui précède l’œuvre au rouge, la « mue imaginale » de la chrysalide en marche vers la lumière, vers son destin de papillon qui se brûlera bientôt nécessairement, par « devoir d’être», à la flamme de la bougie… car le dieu -et c’est là la « science » qui fait supporter la souffrance « avec patience »- habite dans le feu…
Parmerde, mai 1872, rue Monsieur-le-Prince, nuit d’encre, deux heures et demie du matin, l’aube pointe à l’horizon et je pressens sous ma fenêtre la grande masse sombre des arbres du lycée Saint-Louis, et au loin les toits de zinc du quartier latin…
——————
Eternité (ou Résurrection),
——————-
De profundis [de mes profondeurs],
J’ai retrouvé,
Quoi ? L’Eternité !
C’est ma flache noire et froide
Illuminée au soleil naissant…
Ame sentinelle, guettant l’aurore,
Proclame l’aveu
Du nouveau jour en feu
Qui annule ta nuit !
Et voilà que tu t’envoles
Loin au-dessus des soucis
Du servum pecus,
Libre, désormais…
Avec le devoir
De proclamer ces braises
A chaque instant
Sans plus dire « enfin »…
Fini l’espoir impatient,
De voir poindre, chaque matin, un nouvel Orient
Grâce au Savoir guérisseur,
De la passion qui demeure…
J’ai retrouvé
Quoi ? L’Eternité :
Ma flache noire et froide
Enlevée par le soleil levant
Un ami relecteur me demande des précisions sur mon « étude » précédente…
Pour aller à l’essentiel : non, ce n’est pas « d’un coucher de soleil que Rimbaud parle » ici, et ce pour plusieurs raisons.
D’abord, et c’est décisif, en juin 1872, Rimbaud n’avait encore jamais vu la mer (on le savait déjà pour le « Bateau ivre » composé un an plus tôt, l’été 1871) !
Abordons rapidement la question secondaire, et jamais posée tellement cela parait évident, de savoir s’il s’agit d’un « coucher » ou d’un « lever de soleil »… et pourtant !
Evidemment « la mer allée avec le soleil » suggère une plongée du soleil dans la mer, et c’est la lecture quasi unanime et spontanée que l’on fait du poème (Antoine Adam n’y a pas échappé)… Cependant si l’on part du principe (contestable) que Rimbaud dépeint une scène naturelle, tout le monde s’accordera sur le fait que cette scène est arrêtée (« allée » et un participe passé, non un participe présent : l’aspect du verbe est accompli) puisqu’il s’agit d’un tableau, et donc que le mouvement de plongée ou au contraire d’émergence n’a pas de sens. Il y a évidemment les « braises de satin » qui suggèrent plutôt l’atmosphère plus chaude du crépuscule, mais quiconque regarde les « Ports de mer, soleil couchant » ou « levant » du Lorrain constatera la difficulté à discerner le moment de la composition par la couleur (du moins en art), et la lumière, peut-être un peu plus dorée à l’aurore, mais qui peut néanmoins être rosée. Et Mallarmé dans « Don du poème », sur lequel nous reviendrons bientôt, parle d’une aurore « Noire, à l’aile saignante»… Rimbaud lui-même ne donne aucune indication sur le moment de cette « mer allée avec le soleil », et pour cause puisque ça n’en est pas une, et qu’il parlera plus tard de « mer mêlée au soleil » dans la « Saison » : la mer est « mêlée » au soleil à son coucher… comme à son lever (avant de s’en « démêler ») !
Mais plus radicalement la façon d’être de Rimbaud, poète de l’aube, poète du surgissement matutinal, ferait plutôt opter pour le lever de soleil… ou s’agirait-il d’un « crépuscule du matin » pour mettre tout le monde d’accord, jolie périphrase oxymorique par laquelle Baudelaire, poète du soir, désigne l’aurore ?
D’autres indices dans le poème sont plus parlants : l’ « Ame sentinelle » est plutôt du matin : la sentinelle guette l’aurore, pas le crépuscule… et puis cet « aveu [murmuré] de la nuit si nulle et du jour en feu » suggère une nuit « annulée » par le « jour en feu », ce qui dessine bien un mouvement qui part de la nuit et va vers le jour, mouvement du lever de soleil et non celui de son coucher…
Enfin cet envol de l’âme sentinelle fait bien penser à un envol au petit matin, un envol qui permet de se « dégager » de la nuit « des humains suffrages et des communs élans », à moins qu’il ne s’agisse de l’envol de la chouette de Minerve au crépuscule ?
Laissons ce point qui n’est pas l’essentiel mais concerne plutôt la tonalité de l’œuvre et part du principe que Rimbaud décrit ici et peint sur le motif : « Ut pictura, poesis » !
Justement, nous abordons là un point capital de l’analyse qui est une source beaucoup plus importante d’erreur de lecture : la poésie n’est pas la peinture car la poésie (comme la musique) s’inscrit dans le temps (qui nous est beaucoup plus intime) et la peinture dans l’espace, c’est pourquoi la poésie ne peut « imiter » l’espace comme peut le faire la peinture.
Conséquemment cette « imitation » de la Nature dans la poésie ne peut se faire que dans et par le mouvement de l’écriture qui est toujours postérieur à l’instant de la sensation, lié à la Mémoire du poète, décalé par rapport au présent vécu du quotidien (écriture « différée », dirait Derrida), en reprenant analogiquement le processus de création naturel, en recréant la chose (res) non par pure imitation photographique, mais par reconstruction sympathique parallèlement à l’expérience (vécue, pensée ou rêvée), ou au Souvenir, pour en extraire la quintessence dans un temps poétique intemporel, voire ici atemporel, plus présent qu’aucun présent : le poème est intimement mêlé au temps intérieur du poète, à sa mémoire, beaucoup plus qu’à sa sensation immédiate… Il lui faut le long passage du temps pour retrouver la fraîcheur de l’impression première : tout grand poème est une écriture foncièrement inactuelle…
Ici Rimbaud, n’ayant encore jamais vu de « coucher de soleil sur la mer », parle d’un coucher rêvé, d’un coucher intérieur brûlant, qu’il « réalise » dans et par l’écriture poétique : le poème n’épouse pas le mouvement du soleil (réel), mais c’est le coucher (ou le lever ?) rêvé, aux « braises de satin », qui est ressuscité, recréé à partir de l’écriture poétique, comme un Christ lumineux sortant des enfers victorieux « ad matutinum, au Christus venit » ! « De profundis Domine, suis-je bête ! », s’écrit Rimbaud dans « Mauvais sang ».
Dans sa recherche de réel (qui n’est pas du réalisme), le poète traduit spontanément en termes d’infini (lié à l’espace, plus concret) ce qui est pour lui une expérience intime lié au temps : le soleil réel (l’astre) sur la mer est à l’infini ce que le soleil intérieur (la Charité, l’Amour, le Devoir) dans l’âme est à l’éternité… mais c’est du soleil intérieur, et de lui seul, que le poète parle, qu’il a « sous les yeux » et qui brûle sa plume en écrivant, l’autre n’en étant qu’un lointain et bien pâle reflet !
N’oublions pas aussi que Rimbaud ne parle pas d’un « coucher de soleil sur la mer », certes parce qu’il n’en a jamais vu, mais aussi et surtout parce que ce n’est pas Rimbaud qui parle ici… mais le Poète, c’est-à-dire « l’Autre » de son « Je » : « ça parle en lui ». Ce poème est l’un des meilleurs exemples de la poésie objective qui est tout l’objet de la recherche essentielle de Rimbaud, dès les lettres dites du Voyant à Izambard et Demeny de mai 1871.
Enfin le poète ne parle pas d’un « coucher de soleil » parce que son sujet ici (l’aurait-on oublié ?) est l’Eternité, et que le « coucher de soleil » n’est qu’une métaphore pour illustrer le « concept d’Eternité » au sens poétique (qui est l’idée, plus sa réalisation dans le poème).
En début de cette analyse j’ai parlé d’un « lever de soleil » quant au spectacle possible de la nature prétendument évoqué dans le poème, à présent je dirais que le « lever » imaginaire a été aperçu la nuit, comme une apparition, que ce poème est un poème de la nuit : oui, je pense que Rimbaud l’a écrit la nuit, dans « la chambre noire » du développement de l’œuvre poétique, au plus profond d’une nuit d’encre, entre minuit et trois heures du matin (j’y reviens plus bas), et que le soleil qu’il a aperçu alors, le soleil qui s’est levé au plus profond de son « Autre », qui a été « pensé » par cet « Autre » à cet instant, a été d’un éclat jamais atteint par aucun soleil jamais vu : c’est dans les nuits les plus obscures que se lèvent les soleils les plus brillants, avec l’éclat de la lumière intérieure, l’intensité de la présence, que seul le rêve peut donner aux choses ou aux êtres disparus et qui ne se rencontre jamais dans la pâle réalité quotidienne : « Loin des yeux, au plus près du cœur, au cœur du cœur ! ».
Sauf que le poème est plus fort que le rêve, plus réel qu’aucune réalité concrète : il a avec lui la force de la conscience (qui n’est pas la plate rationalité), de la « pensée chantée et comprise du chanteur », du rêve d’un rêveur se sachant et se voyant rêver, et, dans le cas de Rimbaud, pouvant noter telle quelle « sur le motif » les ascensions fulgurantes de sa propre vision intérieure !
Et Rimbaud avait cette conscience de Voyant non pas au crépuscule, mais au petit matin, entre minuit et trois heures du matin précisément, comme il en témoigne dans une lettre admirable écrite de Parmerde (sic) rue Victor-Cousin, Hôtel de Cluny, en Junphe 72 (re-sic, et tiens, c’est la date de composition de « L’Eternité » !) à son fidèle ami Ernest Delahaye, un si beau poème en prose dont voici le plus bel extrait : « Maintenant c’est la nuit que je travaince (sic). De minuit à cinq [heures] du matin. Le mois passé, ma chambre, rue Monsieur-le-Prince, donnait sur un jardin du lycée Saint-Louis [on est loin d’un coucher de soleil romantique sur la mer, il s’agirait plutôt d’une mer… de toits, de tuiles et de zinc]. Il y avait des arbres énormes sous ma fenêtre étroite [exiguïté de la chambre, bien loin d’un espace « infini »]. A trois heures du matin, la bougie pâlit : tous les oiseaux crient à la fois dans les arbres : c’est fini. Plus de travail. Il me fallait regarder les arbres, le ciel, saisis par cette heure indicible, première du matin. »
Pourquoi n’écoute-t-on pas Rimbaud dans des « aveux » aussi essentiels ?
Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, décidément non, ce n’est pas d’un « coucher de soleil que Rimbaud parle » dans « L’Eternité », sinon sa poésie n’aurait pas plus de force que celle d’une carte-postale de station balnéaire intitulée : « Coucher de soleil sur la mer à Ponponette-les-Flots- Bleus»… et Rimbaud ne serait pas Rimbaud, mais Monsieur Jourdain s’amusant à faire des vers.
De grâce, « sachons suivre les vues du poète, ses souffles, son corps, son jour », ne tuons pas dans la platitude de l’analyse et de la lecture l’un des ultimes Voyants qui peut encore nous permettre de percer la couche crasse de photographies, de clichés affligeants, et autres « podcasts » ou vidéos YouTube publicitaires, qui obstruent notre monde « con-necté » -tyrannie tentaculaire de l’image beaucoup plus étouffante et mortelle que celle des « gaz à effet de serre »- et empêchera irrémédiablement les futures jeunes « âmes sentinelles » de regarder « monter en un ciel ignoré du fond de l’Océan des étoiles nouvelles » !
« Arrière ces superstitions, ces anciens corps, ces ménages et ces âges. C’est cette époque-ci qui a sombré !»
Un poète ne « communique » pas, et peu lui importe « d’être compris » : seul à la proue, « aspiciens a longe », il ne se retourne pas pour savoir s’il est suivi, entièrement préoccupé qu’il est par la recherche du « passage » qui le conduira -et l’humanité avec lui, grâce à lui- au « ciel antérieur où fleurit la beauté », uniquement soucieux de « trouver le lieu et la formule »…
A nous de tenter de le suivre : « Et nous nous le rappelons et il voyage… […] Il ne s’en ira pas, il ne redescendra pas d’un ciel […] Sachons cette nuit d’hiver […] le héler et le voir et le renvoyer, et sous les marées et au haut des déserts de neige, suivre ses vues, ses souffles, son corps, son jour ».
Et quelle « formule » lumineuse ici, soumise à notre étude :
« Elle est retrouvée./ Quoi ? – L’éternité./C’est la mer allée/Avec le soleil » !
Formule lumineuse, vraiment, que cette « mer allée avec le soleil » comme image de « l’Eternité » ? Deux strophes plus loin il y est pourtant question de « Devoir », et une strophe plus bas voilà « l’espérance » qui disparait à jamais (« Nul orietur » : « là », plus de renouveau, ni de renaissance possibles), et le « supplice est sûr » : assisterions-nous à une descente aux Enfers ? Serions-nous les témoins d’une inversion de la perspective, verrions-nous un négatif se superposer progressivement à la vision solaire première d’éternité, et ce soleil ne serait-il pas le « soleil noir de la Mélancolie », les « braises de satin », des « braises de Satan » ?
—————–
Regardons -y de plus près :
Que peut bien avoir à faire la vision idyllique d’un coucher de soleil avec le « Devoir » ? La morale hédoniste qui semble proposée dans les trois premières strophes, se confondrait-elle à partir de la quatrième strophe avec une austère morale du Devoir toute stoïcienne : le Devoir de « se mettre en accord », d’agir en conformité avec la Nature (dans un sens qui n’a évidemment rien d’ « écologiste » au sens politique actuel, faut-il le préciser) ? Cela peut s’entendre, et confirme seulement que Rimbaud n’était pas un adepte précoce du « Sea, Sex and Sun », ni des sommeils avachis sur les plages privées d’Ibiza par les longues soirées du mois d’août (c’est plutôt rassurant)…
Bon, nous avançons, un peu…
Mais que diable vient faire cette absence d’ « espérance » à la strophe suivante, et surtout ce « supplice » assuré !
Le « supplice », Rimbaud connait, lui qui a écrit «Le Cœur supplicié » en écho crypté des mauvais traitement subis à la prison de Mazas en 1871, et le mot « ne veut pas rien dire » !
Intéressante aussi est cette « science avec patience » du vers 19 qui semble relier la science d’éternité évoquée dans les vers précédents au « supplice » du vers 20 : la « patience » est l’art de savoir endurer la souffrance, de « pâtir » sans gémir, et « L’Eternité » est justement le troisième poème des « Fêtes de la patience » : la « science » doit me permettre de supporter la douleur, de dépasser le « supplice », qui est cependant « sûr », et auquel on n’échappera pas, ce qui semble contradictoire…
On peut alors se demander si ce « supplice » n’est précisément pas cette « science (acquise) avec patience », au prix d’ineffables difficultés, d’efforts surhumains ?
Mais faut-il vraiment chercher un sens de « fond » au poème ? Son sens ne résiderait-il pas dans sa « forme », l’initiative ne serait-elle pas laissée aux mots seuls, comme le soutiendra Todorov ?
Plus l’on creuse le poème et plus sa charpente apparait comme l’intrication inextricable de résonances phonétiques qui renvoient l’une à l’autre, de champs lexicaux qui s’interpénètrent, de jeux sur les étymologies qui s’appellent l’une l’autre, de renvois à des textes qui apparaissent entre les lignes pour qui sait les voir, et le tout en référence quasi permanente, positive ou négative, au christianisme (« Je suis esclave de mon baptême », avouera Rimbaud dans la « Saison ») : ainsi la « science » est contenue phonétiquement dans la « pa-tience » qui renvoie au « supplice » (via le « pâtir »), et comment ne pas voir dans cette « espérance » interdite -et ce « nul orietur » qui joue à la fois sur « orior » (« se lever », « oriri, ortus sum », verbe déponent, ici à la 3ème personne du futur) et « oro » (« prier », « orate (fratres) !» à l’impératif) : « No future » et « Dieu est mort », dans une même et unique expression- un rappel à peine déguisé à ce terrible avertissement affiché à l’entrée de l’Enfer de la « Divine Comédie », au début du Chant III : « Lasciate ogni speranza, voi che ’ntrate » (Abandonnez toute espérance, vous qui entrez ici) ?
La «Saison en enfer » (bien de Rimbaud, celle-là) de 1873 à travers son travail de déconstruction des « Derniers vers » du printemps 1872 dans « Alchimie du Verbe », et notamment de « L’Eternité », sépare plus nettement ( à l’aide d’un tiret en attaque du treizième vers) les trois dernières strophes des trois premières, et inverse la 4ème et la 5ème du poème selon la forme soumise à notre étude : la 4ème strophe de la « Saison » commence donc par « – Jamais l’espérance./ Plus d’orietur,/ Science et patience,/ Le supplice est sûr », et la 5ème strophe poursuit : « Plus de lendemain,/ Braises de satin,/ Votre ardeur/ Est le devoir ».
Rimbaud nous fait ici rentrer directement dans l’enfer du « supplice » (et d’ailleurs, en présentant le poème, ne dit-il pas qu’il « écartai[t] du ciel l’azur, qui est du noir » ?) et, après l’envol prometteur d’Icare vers une aurore éternelle dans la 3ème strophe (« Donc tu te dégages/[…] Tu voles selon… »), annonce sans transition l’abandon de toute « espérance » à qui contemple « la mer mêlée au soleil », sans passer par la case préalable du « Devoir » qui apparait seulement dans la 5ème strophe, rapprochant peut-être ici de manière plus manifeste « supplice » et « devoir » (via l’ « ardeur » des « braises ») : une sorte d’union mystique païenne avec le soleil, un « supplice » qui n’est pas sans rappeler dans le « Veni Creator Spiritus » la brûlure au feu sacré divin de la Charité qui doit enflammer le cœur des fidèles (« Viens Saint Esprit et allume en nous le feu sacré de Ton Amour !») ? « J’ai songé [en 1872 ?] à rechercher la clef du festin ancien, où je reprendrais peut-être appétit. La charité est cette clef», écrit Rimbaud dans la « Saison », avant de vite rajouter : « Cette inspiration [que l’on retrouve dans les « Derniers vers » de 1872 ?] prouve que j’ai rêvé ! ». Car ces « chansons de mai » pentamétriques sont bien des cantiques spirituels, n’en doutons pas : nous revenons par là à une lecture porteuse d’un sens spirituel !
Dans une approche plus étymologique, l’un des sens possibles de « supplicium » en latin n’est pas « supplice » mais « supplique », « supplications », « prières », et l’on connait toute la maitrise de la langue latine par Rimbaud et son souci de la précision des termes, lui pour qui « l’œuvre » devait être « la pensée comprise et chantée du chanteur » (on est loin ici de l’à-peu-près romantique et du pur « ressenti de la beauté poétique » auquel nous invitent les jouisseurs paresseux)…
Ce qui peut donner un autre sens au vers 20 : « Le supplice est sûr » pourrait vouloir dire : « La supplique, en contemplant les braises solaires pour s’y nourrir d’un « devoir » sans cesse renouvelé, est une science qui avance d’un pas assuré et patient dans l’adversité pour parvenir in fine à la vision d’éternité» (« Supplice » serait ici relié à « Science », mise en apposition, plus qu’à « Devoir ») !
« Nul orietur », certes, mais « orate (fratres) » pour persévérer avec « patience » dans votre « Devoir » de contemplation !
Le « supplice » évoqué ne serait donc pas celui de l’Enfer, mais celui du feu de la Lumière et de l’Amour enduré par les Fidèles d’Amour (« l’amour, mesure parfaite et réinventée »), un peu à la façon de ces papillons qui brûlent leurs ailes à la flamme de la chandelle autour de laquelle ils tournent et tournent, jusqu’à s’y con-fondre, comme les derviches autour de leur centre, jusqu’à la « passion » fusionnelle finale…
Rimbaud se rira bientôt de cette con-fusion solaire dans la « Saison » tout en donnant de très précieuses indications sur son projet initial : «[…] et je vécus, étincelle d’or de la lumière nature. De joie je prenais une expression bouffonne et égarée au possible » (autodérision rageuse, mais ô combien éclairante !).
Une grille de lecture du poème peut aussi se trouver dans cette dichotomie entre « temps » et « espace », « éternité » et « infinité » : comment parvenir à « l’éternité », seul objet du poème, dans la contemplation d’un paysage, même « infini » ? L’espace infini ou lumineux peut se saisir dans un regard ou un tableau (et les couchers de soleil du Lorrain nous le prouvent suffisamment), car nous sommes « dans » l’espace que l’on peut arrêter et parcourir en tous sens, mais la flèche du temps est irréversible, d’où l’échec assuré de parvenir à « l’éternité » par la contemplation de « l’infini » qui est dans le temps : « Le supplice (i. e. l’échec à terme) est sûr », car on ne sort pas du temps… L’infini est spatial, il est une catégorie de l’espace (un espace sans limites), l’éternité est atemporelle, elle n’est pas une catégorie du temps (elle n’est pas un temps infini) : elle est son contradictoire, il y a le temps… et l’éternité, qui est atemporelle (et non intemporelle)… « Là » où est « l’éternité » il n’y a alors plus « d’espérance », vertu théologale qui préserve la vision béatifique dans le temps terrestre et permet de l’endurer avec « patience » : seule la « charité » demeure, qui est fusion de l’âme (son « supplice », sa « passion ») au feu sacré de l’Amour !
Un « Devoir » qui renait de ses cendres en permanence dans « l’ardeur des braises de satin» (serait-ce là une évocation de « l’œuvre au rouge » ?) et tue de soi toute « espérance » (c’est-à-dire toute emprise du temps dans l’attente d’un lendemain) dans l’effusion passionnelle et cathartique de la Vision, Amour à l’état pur : telle est l’Eternité promise à « qui a des yeux pour voir » !
Je pense que nous avons fait là une avancée décisive dans la compréhension du poème car cette Vision du coup ne saurait se dérouler dans l’espace, même infini, ni même foncièrement dans le temps, mais à partir du temps : elle est épochè temporelle (comme le néant est non-être, et s’expérimente à partir de l’être, dans l’angoisse ou l’absence), mise entre parenthèses du temps à partir d’une expérience spatiale spectaculaire (un coucher de soleil) traduite aussitôt à partir du temps vécu (la brève durée d’un coucher de soleil), en termes a-temporels dans et par le poème, dans et par le langage : selon les vœux du poète, le temps a pu ici « suspendre son vol » !
Et finalement, quelle que soit la grille de lecture adoptée (purement formelle, sensualiste, intertextuelle, spirituelle (chrétienne ou païenne), étymologique, alchimique, symbolique etc.) nous revenons toujours à la création poétique comme le centre de la toile à partir duquel se tisse l’unité du poème, comme exercice d’un langage qui rayonne à partir des mots bien au-delà des mots, comme la lumière est à la fois démultipliée et intensifiée dans l’éclat d’un vitrail : le vitrail, semblable à la parole poétique, n’est pas transparent (parole prosaïque), il est translucide, il ne laisse pas voir le soleil tel quel (comme dans la prose), il ne crée pas de lui-même à partir de rien (comme dans l’art pour l’art), il magnifie la lumière préexistante, il la réinvente, la rend encore plus lumineuse, il nous la fait voir, surtout si nous savons y mettre les mots pour faire durer l’expérience dans l’intemporalité du Souvenir (le temps retrouvé) ou l’atemporalité de l’Eternité…
Je dois confesser n’avoir jamais rien vu dans la peinture de Soulages et son « outre-noir »… si ce n’est du noir désespérant et plat (avec parfois quelques touches de bleu ou de rouge, si bien venues), tout juste de la peinture « art et déco » pour habiller un mur blanc… et pourtant j’ai toujours aimé entendre le peintre parler si bien de son art et de sa « découverte », avec des mots si forts, si enthousiastes, que pour un peu j’aurais presque pu, par la simple suggestion des mots, voir la lumière immatérielle danser en avant de « l’œuvre au noir » !
Soulages est pour moi avant tout un grand… poète !
Et que serait la visite d’un musée sans les notices explicatives, sans les critiques d’art, sans les regards aiguisés de Proust, de Baudelaire, de Malraux, de Maldiney et tant d’autres spécialistes d’esthétique qui nous aident à mieux lire les bleus de Cézanne, les ors de Giotto, le mouvement chez Delacroix, et permettent à notre émerveillement premier si éphémère de durer, de s’amplifier, de s’approfondir, de s’enraciner dans notre histoire, et de croître avec l’âge et le temps grâce aux mots qui nous rendent plus « conscients », c’est-à-dire plus amoureux ?
La vraie majesté d’un coucher de soleil ne saurait être durablement que poétique, vision intérieure nourrie au spectacle de la nature que nous expérimentons avec le temps vécu (la durée) et à partir duquel l’âme s’envole « selon », grâce au langage seul, par lui, avec lui et en lui (et le reste n’est que gratouillis passager, bouffée de chaleur) : ce n’est plus Rimbaud qui parle mais l’« Ame sentinelle », l’ « Autre » du « Je », et voilà que le soleil se reflète dans le poème, irradie à partir du centre du poème qui nous brûle soudain : le soleil qui se couche sur l’océan, c’est dans le poème qu’il m’apparait en majesté, et non dans le spectacle naturel -ou si peu, et si peu de temps- car ce n’est plus du soleil qu’il s’agit mais d’une autre lumière bien plus éblouissante qui a pris le relais et que plus aucune nuit (« la nuit si nulle », celle « des communs élans et des humains suffrages ») ne peut plus désormais obscurcir : c’est un soleil qui ne se couche jamais, celui d’un « jour (à jamais) en feu » !
Ni l’astre solaire, ni aucun spectacle, photographie ou tableau, ne saurait par lui-même et à lui seul conduire à l’Eternité si le terreau de « l’âme sentinelle » n’est pas prêt à recevoir «l’étincelle d’or » de la vision intérieure et poétique liée « essentiellement » (i.e. « par essence ») au langage créatif et performatif : « Ame sentinelle » tu te « dégages et voles selon », « là » (déictique si important qui revient deux fois dans le poème et marque toute l’actualité de la parole poétique), au moment où le poète le dit, et à chaque fois que je le dis avec le poète, ni avant, ni après…
Le soleil réel -même l’astre du midi, pourtant le plus « immobile » des soleils, en apparence- n’est qu’un leurre d’éternité, « l’ombre [d’une] tortue » qui nous abuse et nous tue lentement mais sûrement -alors que dire du soleil crépusculaire ?- comme vecteur principal de la flèche assassine du temps : « Zénon ! Cruel Zénon ! Zénon d’Elée !/ M’as-tu percé de cette flèche ailée/ Qui vibre, vole, et qui ne vole pas ! Le son m’enfante et la flèche me tue !/ Ah le soleil… Quelle ombre de tortue/ Pour l’âme, Achille immobile à grand pas ! ».
« C’est la mer allée avec le soleil »
C’est d’un coucher de soleil dont Rimbaud parle. L’éternité, comme une révélation, c’est l’infini du poète , cette idée puissante hors du temps et au delà des hommes. (Voir Strophe 3)
« Des humains suffrages,
Des communs élans
Là tu te dégages
Et voles selon »
Mais pour y accéder, il faut être un peu voyant. Voir dans ce spectacle de la nature une porte vers l’infini demande un effort. (Voir strophe 4)
« Puisque de vous seules,
Braises de satin,
Le Devoir s’exhale
Sans qu’on dise : enfin. »
L’infini (ou l’éternité) c’est la foi retrouvée, en dieu et à la poésie sacrée (Lamartine)
Céline avait écrit : « L’amour , c’est l’infini mis à la portée des caniches ». Traduction : Une ruse des dieux , une illusion de l’infini.
L’éternité est donc dans la nature seule (Les falaises d’Etretat pour Tesson, un coucher de soleil pour Rimbaud…).
Un rectificatif d’ordre chronologique à mon propos (sauf erreur) : la phase « alchimique » n’est pas londonienne, mais bien parisienne et ardennaise (été 1871, lettre à Demeny, jusqu’en septembre 1872, premier départ avec Verlaine à Londres précisément, « et peut-être au-delà » précise tout de même Suzanne Bernard dans son très bel article sur la « Palette de Rimbaud »- 1959- accessible sur internet pour les passionnés (https://www.persee.fr/doc/caief_0571-5865_1960_num_12_1_2169), où elle fait très finement la part des choses entre « un emploi impressionniste et un emploi symbolique des couleurs » chez Rimbaud).
Cette « Alchimie du verbe » (hallucination verbale) , qui succède à une « alchimie de l’être » (hallucination première) -travail sur soi, ou » dérèglement de tous les sens », avant le travail sur les mots proprement dit- n’est autre donc que l’aboutissement et la mise en pratique de la théorie du Voyant qu’ « Une saison en enfer » viendra dénoncer comme « l’histoire d’une… folie », sans doute à cause de cet éloignement trop grand du « réel » auquel elle a conduit le poète (tendance qu’illustre bien les « Fêtes de la patience », et notamment « L’éternité » ici : « Des humains suffrages/ Des communs élans/ Là tu te dégages / Et voles selon »).
Contrairement à Baudelaire en quête de « paradis artificiels » et d’un idéal presque platonicien dans le ciel des… Images (qui lui n’est pas platonicien), Rimbaud est un poète paysan, un poète de la Nature et de la terre : il ne cherche pas à percer la couche nuageuse pour échapper au spleen, il ne veut pas dépasser le monde vers un « autre monde » qui serait seul vrai, il veut « le changer » poétiquement (en 1872 du moins, après être revenu de ses velléités politiques de 1871) en portant dessus un regard neuf qu’il retranscrit et partage dans ses poèmes…
« La vraie vie est absente »… dans un seul monde : « on ne part pas »…
» Reprenons donc les chemins d’ici » pour changer les choses et « posséder la vérité dans une âme ET un corps ».
Troisième poème des « Fêtes de la patience » des « Derniers vers », ce poème de mai 1872 est l’aboutissement poétique de la « Chanson de la plus haute tour » étudié plus haut, qui le précède immédiatement dans le recueil juste avant «L’Age d’or ».
Dans la « Chanson » nous avons vu que Rimbaud-le-Poète prend son essor au moment même où l’adolescent, Arthur-l’oisif, semble ressentir l’impasse de la tentative du Voyant (« Oisive jeunesse/ A tout asservi/ Par délicatesse/ J’ai perdu ma vie ») -sentiment dont il semble prendre exagérément conscience avec une ironie féroce dans le si beau poème autobiographique de la « Saison en enfer » en 1873, « Alchimie du verbe », qui nous livre une deuxième version intéressante de plusieurs poèmes des « Derniers vers »- et nous avons même parlé d’échec : échec de la réussite sociale poétique du jeune Arthur qui voulait être reconnu par ses pairs parisiens (qui est « monté à Paris » pour cela, avec « Le Bateau ivre » dans ses bagages) et que tout le monde (sauf Verlaine) ignore, échec sur le plan de la santé physique et mentale où il a frôlé, et même atteint la folie, « la folie qu’on enferme », échec enfin poétique quand il semble être parvenu dans une voie sans issue qu’il lui faut au plus vite quitter…
Etait-ce vécu de la sorte par le poète de 1872 ? Le Rimbaud de 1873 n’est-il pas beaucoup plus désespéré que celui des « Derniers vers », surtout après la grande crise bruxelloise de l’été avec Verlaine ?
A la lecture de «L’Eternité », comme des autres poèmes du recueil, l’on ressent au contraire une grande paix, une sérénité hors du temps qui marque l’un des sommets de la poésie universelle, comme si le poète se regardait de l’extérieur, comme si son « âme sentinelle » s’était décorporée pour fouler enfin, dans ces vers musicaux presque immatériels et intemporels, ces « grandes plages sans fin couvertes de blanches nations en joie » dont il parlera dans « Adieu », lieux rêvés d’où il peut enfin contempler « la mer allée avec le soleil », ou plutôt être contemplé par elle… car ce n’est plus le poète qui parle ici comme dans la « Chanson » (aucun « je » n’apparaît plus, seul un « nous » qui s’allie à l’ « âme sentinelle » semble en révéler la présence cachée : « Murmurons l’aveu»), mais la Poésie qui parle désormais en lui et la Poésie est devenue miroir de l’être, la mer se reflète dans le poème…
A ce moment, l’ « âme sentinelle » (à laquelle le Poète s’adresse de nulle part, à la deuxième personne) s’est « dégagée » des « humains suffrages » (i.e. du point de vue humain particulier) et peut « voler selon » car elle a enfin atteint le rivage de la Poésie objective qu’elle parcourra désormais librement dans les « Illuminations » (l’on peut d’ailleurs penser que certains poèmes des « Illuminations » sont contemporains des « Derniers vers ») : « Je est [devenu] un autre », comme le jeune Arthur l’annonce de façon prémonitoire dès 1871 dans la Lettre du Voyant…
Oui, par son projet de voyance, Arthur l’adolescent oisif surdoué a perdu sa vie particulière… mais Rimbaud-le-Poète est né à la vraie Vie universelle !
A la suite d’une nouvelle crise à Londres qui a entraîné des études que l’on pourrait qualifier d’« alchimiques » (« Alchimie du Verbe »), le Poète semble donc avoir atteint dans les « Derniers vers » un infini dans lequel il s’est anéanti en acceptant ce qui peut être défini, d’un point de vue platement humain seulement, comme un échec : Verlaine parle à la même époque, quand lui-même compose ses « Romances sans paroles », d’ « Etudes néantes » qu’aurait projetées Rimbaud -une version païenne de l’union mystique en Dieu- à travers l’étude de ces « espèces de romances », ces « rythmes néants » qui n’ont cependant rien de « naïfs », ni ne sauraient être définis comme des « refrains niais » comme il les qualifiera ironiquement dans la « Saison »…
Et ces « études » exténuantes, cette recherche « de pointe » aurait dit René Char, expliquent la cinquième strophe, impossible à analyser si l’on se contente d’une interprétation purement hédoniste et sensualiste du poème et que l’on oublie que la Poésie est d’abord création, donc activité par excellence : que peuvent bien être ce «là, pas d’espérance », cette « science avec patience », ce « supplice sûr » s’il suffit de s’abandonner à l’instant présent, allongé sur une plage au soleil couchant, pour rejoindre l’Eternité ?
Non, il ne suffit pas de se bercer d’espérances (d’illusions) comme il a pu le faire en rêvant de Révolution par exemple, ni de s’abandonner passivement aux sens, pour rejoindre l’éternité : il y a un « devoir » à accomplir et la « réalité rugueuse à étreindre » quotidiennement, dans et par la contemplation des « braises de satin », l’observation de la chose même à laquelle il faut se soumettre et qu’il faut savoir voir et recréer poétiquement, il y a un exercice à faire (et quel exercice, d’une difficulté inouïe !), une « science » qu’il faut étudier avec « patience » et qui est une forme de « supplice » accepté car nécessaire pour atteindre enfin ce réel insaisissable après lequel Rimbaud a couru toute sa vie, comme après l’Aube des « Illuminations » étudié ailleurs : l’anéantissement dans l’infini n’est pas morne passivité, quiétisme, mais pure activité, la soumission au « devoir » n’est pas un laisser-aller nonchalant sur la plage (le « sommeil bien ivre » dont il parlera plus tard, toujours dans la « Saison », quand les nerfs auront craqué et que le « système » se sera effondré, avant de repartir différemment), elle est un effort sur soi au sens stoïcien pour se mettre en accord avec la Nature, une ascèse sans cesse recommencée pour gagner l’Eternité…
Tu n’as plus besoin
De l’avis du peuple
Ni de ses triviales aspirations
Et tu t’envoles libre.
« Des humains suffrages,
Des communs élans
Là tu te dégages
Et voles selon »
I’m tired but i can translate
from human choice
from ordinary joys
Now you are free
flying as a bee
« From human opinions/judgments,
From popular endeavors/ventures, »
why not? But I can translate too:
From human choice
And from shared joys …
Quant à la mer allée avec le soleil ok pour « mixed » mais déjà en français on peut entendre beaucoup de choses et voir de belles métaphores comme la mer hâlée avec le soleil la mer comme un bateau et le soleil un hâleur on peut entendre allée comme faisant l’amour avec le soleil
Not easy to translate, but:
Flautiste dit :
13 février 2020 à 16:29
Natalie Penn :
Des humains suffrages,
Des communs élans
Là tu te dégages
Et voles selon
From human opinions/judgments,
From popular endeavors/ventures,
One frees oneself
And fly accordingly
That would be my translation.
to respect rythm and short verses:
from human wishes,
from common surges
thou act to go away
and fly free on the way
la langue française est imbattable en tonalités , en musique, dans ses poèmes.
les Chinois disent qu’elle est en ce sens la plus belle langue du monde
Je suis d’accord avec Nath.
Plusieurs façons de lire et comprendre ce poème.
Tel un Alchimiste des mots.
L’amère allée …
« Science avec patience,
Le supplice est sûr. »
La classe absolue d’un génie poétique. Merci Arthur
Esceque l’on pourrais avoir la date svp ou si qqln peut me répondre avec un autre commentaire merci
Pourquoi « allée » si c’est un halo ? Ça reste un profond mystère ce mouvement qui va devant cet « avec » … « Tu marchera dans le soleil et moi j’irai sous la terre » : dernière prémonition du poète qu’il adresse à sa sœur sur son lit d’hôpital …
« Toi, l’autre hiver, plus sourd que les cerveaux d’enfants »
Merci
A la fin de Pierrot le fou, Ferdinand (Belmondo) s’entoure la tête de bâtons de dynamite multicolores sur un promontoire de Porquerolle, face à la Méditerranée. Il allume la mèche avec peine dans le grand vent et tente finalement d’éteindre le cordon bickford en s’exclamant « mais après tout je suis con… ».
Trop tard, il explose. La caméra panote vers le soleil couchant au-dessus de l’immensité bleue et une voix off chuchote : « Elle est retrouvée. Quoi? L’éternité, c’est la mer allée avec le soleil. »
Et je n’entends plus le murmure plaintif et lancinant des vagues
Époumonnées, elles se sont arrêtées..
Elle est recouvrée, quoi, l’éternité
Magnifique!
@Nathalie
La strophe veut dire qu’il se « dégage » (il se libère) des « humains suffrages » (des actes par lesquels on déclare sa volonté, c’est à dire les buts, les projets dans la société des hommes), « Des communs élans ! » (de l’idée qu’il se positionne par rapport aux autres) « Et voles selon » (tu voles là où tu veux).
Dans la saison en enfer ce texte est un peu modifié par Rimbaud, et c’est un peu plus intelligible
Donc tu te dégages
Des humains suffrages,
Des communs élans !
Tu voles selon…
Fabuleux poème. Un de mes favoris de Rimbaud et de toute la littérature française. Un poème à méditer est utiliser pour méditer…
A Julien,
C’est votre opinion.
« Elle est retrouvée.
Quoi ? – L’Eternité.
C’est la mer allée
Avec le soleil. »
Ces quelques phrases sont, pour moi, d’une puissance inouïe. Une simplicité extrême qui exprime une image intemporelle et infinie.
Elles résonnent en moi depuis la première fois où je les ai entendues (et non lues).
C’est mon opinion.
En tout cas, je retiens une perle, que vous dépasserez un jour, je l’espère : demander à un poète de s’expliquer dans un poème, c’est ne pas comprendre le sens même de là poésie.
A Julien
La poésie est une transfiguration du réel et n’a pas besoin d’explication. Elle parle par images et musique, elle parle aux sens et non à la raison. Elle parle en évoquant ce qui est plus subtile qu’une explication logique et crue. Elle dit l’indicible de notre monde. La poésie est nécessaire à l’âme comme l’est l’air à nos poumons.
Moi, je trouve ce poème nul (ou plutôt, cette façon de s’exprimer inutile). À quoi bon chercher à savoir ce que l’auteur a bien voulu dire ? Il n’avait qu’à être plus clair ou s’expliquer en fin de poème.
Natalie Penn :
Des humains suffrages,
Des communs élans
Là tu te dégages
Et voles selon
From human opinions/judgments,
From popular endeavors/ventures,
One frees oneself
And fly accordingly
That would be my translation.
Nathalie,
Il n’y a plus d’attentes, plus de recherche du commun ou de l’acceptation des autres. Arthur Rimbaud – son âme? – se libère des dernières entraves, et vole.
Pour natalie:
Cela signifie pour moi que l’âme du poète se libère, dépasse l’humanité et ses préoccupations « communes »…
Peut-on me donner l’information sur l’Editeur de ce poème
Vos interrogations sont tellement légitimes, que les spécialistes y apportent plusieurs réponses et je vous conseille d’essayer de lire : http://abardel.free.fr/petite_anthologie/l_eternite_commentaire.htm
Je suis anglaise et je ne comprends pas le stanza suivant:
Des humains suffrages,
Des communs élans
Là tu te dégages
Et voles selon
Les humains suffrages, est-ce que cela veut dire ‘les souffrances humaines’ ou est-ce qu’il décrit de la politique: est-ce qu’il s’agit de voter? Je ne comprends pas, et j’ai vu une traduction en anglais, mais ça n’a pas du sens pour moi, non plus.
Peut-on m’aider un peu à comprendre?
Merci bien
C’est beau !
C’est simple, c’est beau et ça fait rêver d’éternité !
J’aime la légèreté des pentamètres et leur fausse modestie.
Simple et très beau !