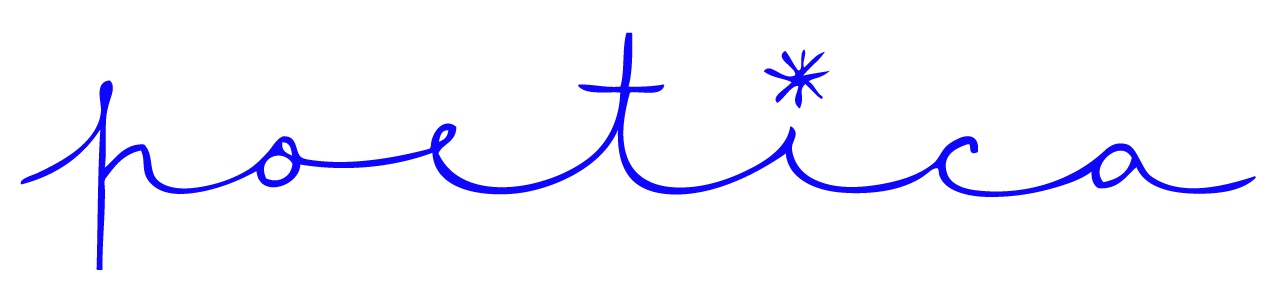I
Idéal ! Idéal ! sur tes traces divines,
Combien déjà se sont égarés et perdus !
Les meilleurs d’entre nous sont ceux que tu fascines ;
Ils se rendent à toi sans s’être défendus.
Ce n’est point lâcheté, mais fougue involontaire,
Besoin d’essor, dégoût de tout ce qui périt,
Pur désir d’échapper à l’affreux terre-à-terre,
A ce joug du réel qui courbe et qui meurtrit.
Séducteur souverain, c’est ta main qui les aide
A secouer leur chaîne, à jeter leur fardeau,
Et quand la Vérité les trouble et les obsède,
Tu mets devant leurs yeux ton prisme ou ton bandeau.
Afin de mieux tromper leur âme inassouvie,
Tu prends le nom d’amour en traversant leur vie.
A ta voix ils feront, passagers ici-bas,
Du désir affolé leur boussole suprême.
Dans l’incommensurable ils ouvrent leur compas ;
L’objet de leur poursuite est l’impossible même ;
II leur faut avant tout ce qui n’existe pas.
Par un courant fatal poussés vers le mirage,
Ayant perdu leur lest, jeté leurs avirons,
D’avance ils sont, hélas ! dévolus au naufrage.
Si la réalité seule est le vrai rivage,
Plutôt que d’aborder, ils s’écrieraient : « Sombrons ! »
Sombrez donc, sombrez tous, les uns après les autres,
Toi qui ne tends qu’au ciel comme toi qui te vautres.
A tous deux l’Idéal ouvre un gouffre enchanté,
Qu’il soit l’amour divin ou bien la volupté.
Mais avant de partir, chacun pour son abîme,
Sous un commun éclair, ne fût-ce qu’un moment,
Le débauché splendide et l’ascète sublime
Se seront rencontrés dans le même tourment.
II
Les voilà déjà loin, suivant leur destinée.
Au frêle amour humain arrachant son flambeau,
Tu tombas tout à coup dans ta course effrénée,
Toi qu’on nous peint d’abord si candide et si beau.
Victime du désir, plein d’une ardeur étrange,
Tu t’acharnais en vain à fouiller dans la fange.
Et descendais toujours sans cesser d’aspirer.
Oui, jusqu’au bout tu crus, sous ta lèvre pâlie.
Obtenir de l’ivresse en t’abreuvant de lie ;
Tu ne parvins pas même à te désaltérer.
Chaque jour plus ardent, vers de nouvelles ondes
Nous te voyons, don Juan, haleter et courir,
Criant toujours : « J’ai soif ! » à ces sources profondes
Que d’une haleine en feu tu venais de tarir.
Enfin, l’enfer s’ouvrit. Dans ce gouffre des âmes
Tu t’es précipité, plongeur passionné ;
Et qu’as-tu découvert ? — Des démons et des flammes.
— Mais tu les connaissais avant d’être damné !
III
Ah ! qui nous donnera, sur l’autre route ouverte.
Le courage de suivre un plus noble égaré ?
Il n’en périt pas moins ; le divin fut sa perte :
C’est vers en haut qu’il prit son vol désespéré.
A l’ardeur de ses vœux que ce monde eût déçue,
Et quand les passions tentaient de l’agiter,
C’est du côté du ciel qu’il cherchait une issue,
Sachant que toute flamme est faite pour monter.
Non, malgré la jeunesse, et sa fougue et ses fièvres,
II ne vous connut point, transports avilissants,
Et le jeune homme ardent n’a pas sali ses lèvres,
Tout altéré qu’il fût, au vase impur des sens.
Qu’à de commun son âme avec la chair fragile ?
Dût sa force se perdre en des élans ingrats,
Plutôt que d’embrasser une idole d’argile,
Au fantôme divin il a tendu les bras.
S’il crut parfois sentir, le grand visionnaire,
Battre le coeur d’un Dieu sur son cœur de chrétien,
C’est que pour l’animer, ce cœur imaginaire,
Il lui prêtait l’amour qui débordait du sien.
Toi, son premier flambeau, Science, il te renie ;
Le miracle est sa loi. Vers un monde inconnu
Des ailes le portaient, d’envergure infinie ;
Dans l’illusion pure elles l’ont soutenu.
Des mains de l’Idéal, et préparé pour elle,
Cette dominatrice absolue et cruelle,
La Foi t’a pris, Pascal, et ne t’a plus rendu.
Que ta raison résiste, aussitôt tu l’accables.
En un jour solennel coupant ses derniers câbles,
Tu lanças vers le ciel ton esquif éperdu.
Seul but de ton essor, vertigineux, rapide,
L’abîme était en haut, mais profond, mais perfide,
Qui t’attirait à lui comme un divin aimant.
Aussi, sans l’arrêter tu montais en plein vide ;
Pour ton âme emportée et toujours plus avide
L’ascension s’achève en engloutissement.
IV
Implacable Idéal ! enfin, ton œuvre est faite.
Au gré de tes désirs, sous ton souffle enivrant,
Le supplice fut double et double la défaite.
Tu peux t’enorgueillir, ton triomphe est navrant.
On te donne deux coeurs, deux grands cœurs que la vie
A ses combats ainsi qu’à ses fêtes convie,
Qu’elle allait couronner en vrais triomphateurs,
Oui, deux êtres, la fleur de l’humaine nature.
Qu’en fais-tu ? Des martyrs, des fous, des déserteurs.
Leur aspiration ne fut qu’une torture ;
Car tu ne repais point ; tu ne veux que leurrer.
Toi qui les affamais, tu leur devais pâture,
Et tu ne leur donnas qu’une ombre à dévorer !
Louise Ackermann, Poésies Philosophiques